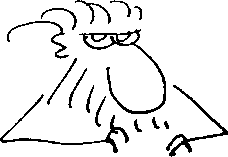Quand j’étais jeune, j’étais stupide. Mais vraiment très stupide. Irréfragablement stupide. La sagesse populaire affirmait que ça s’améliorerait avec l’âge. Ayant fortement pris de cet âge censé améliorer un départ peu glorieux, je peux te confirmer que non, ça ne s’améliore pas avec l’âge. La seule chose qui s’améliore avec l’âge, c’est l’âge. Encore qu’améliorer n’est pas forcément le bon terme. En quoi 59 serait-il une amélioration de 19 ?
L’âge — et il me semble t’en avoir déjà parlé — ne sert qu’à donner raison à Brassens : L’âge ne fait rien à l’affaire. Quand on est con, on est con.
Avec cependant un bémol. Ou un dièse. Je ne suis pas musicien, je ne sais pas faire la différence. Si tu as, toi aussi, le malheur de ne pas être musicienne, remplace astucieusement ce bémol ou ce dièse par un élément de ton choix à condition qu’il évoque la nuance indicible entre le grège et le beige sur un sable à peine humidifié par un vin blanc clairet.
Je n’en suis évidemment pas fier car c’est indépendant de ma volonté mais je suis bien obligé d’admettre que je suis désormais à classer dans la peu enviable catégorie des « vieux cons », peuplée plus que nécessaire de carcasses inutiles ne faisant plus guère de différence entre vieillir et moisir.
Déjà, quand j’avais l’âge d’être jeune, il arrivait qu’on me prenne pour un vieux. Déjà solitaire, déjà blasé, déjà hors-jeu, je guettai l’occasion qui définitivement me sifflerait « hors je ». Mais guetter n’est pas suffisant. Encore faut-il savoir bondir sur l’occasion quand celle-ci se présente. Et j’ai toujours été nul en sport. Et puis l’eau était froide.
Alors les occasions se sont lassées et la vie a repris son cours neutre et monotone jusqu’au jour où… C’est un des inconvénients au fait non pas de vieillir mais de moisir : on perd… Mince. Qu’est-ce que j’ai encore perdu ? Je l’avais écrit quelque part pour m’en souvenir… Ha, voilà ! On perd la mémoire. Du coup, je ne sais plus ce qui a bien pu se passer ce jour-là malgré que j’en garde une trace auditive qui oscille entre une surdité monophonique et de brefs mais violents acouphènes réprobateurs.
Confinement oblige, je te propose un petit flashback vers une solution de déconfinement qui, encore aujourd’hui, est la plus efficace de toutes les clés des champs. Mais auparavant, je te fais remarquer — et sans vouloir t’affoler — que le mot « déconfinement » n’a jamais existé. Un confinement est, de par sa nature lexicologique, irréversible.
C’est exactement ce que je pensais du confinement mental dans lequel j’étais alors englué sans avoir jamais trouvé le moyen d’en sortir durablement. J’avais bien quelques pistes. Notamment les pistes des bandes magnétiques sur lesquelles j’enregistrais les émissions musicales des radios sans jamais les réécouter ensuite, soit que le résultat était rendu inaudible par une quantité de larsens tout juste moins nombreux que les criquets qui aujourd’hui affame le Kénya dans l’indifférence à peine masquée des médias encovidés, soit que tout à ma hâte de n’en pas louper le début j’ommettais simplement d’appuyer sur le bouton Record. Car ce petit appareil japonais, bien que fabriqué en Chine, ne parlait que l’anglais.
Du coup, je ne m’évadais de ce monde que le temps de ces émissions et mes jailbreaks d’alors avaient tout du failbreak !
Jusqu’au jour où…
Flashback !
Le ciel était certainement bleu. Ou gris. Je ne m’en souviens pas. Mais je me souviens de la pochette de l’album. Aussi parce que, magie du numérique, je l’ai actuellement sous les yeux. Le fond opaque, presque noir, comme un miroir dans lequel je me voyais sombrer. La calligraphie du nom du groupe. Dernière trace d’une ère psychédélique qui sera bientôt ensevelie sous les paillettes d’un business plus que jamais acéré. Une calligraphie étonnement proche de la façon dont je traçais mes premiers écrits. Seule la couleur de l’encre différait. Là où l’album envoyait un rouge élégant mais déterminé semblant dire à qui le convoitait : à tes risques et périls
, mes écrits se baignaient avec avidité et complaisance dans une encre plus noire qu’une nuitée d’ennui. Aucun musicien ne figurait sur la pochette, ni recto, ni verso, seulement symbolisés par cinq diamants aux carats identiques.
À l’intérieur de cette pochette, une autre pochette. Avec les cinq musiciens en posture de scène. dans une peinture à la fois naïve et salvadordaline, époque montres molles. Comme pour arrondir les angles tranchants des diamants. Parce que la vie est une blague. Parce que seule la musique importe. À l’intérieur de cette deuxième pochette, le vinyle sur lequel se reflétait, honteuse, la luminescence blafarde d’une lampe de bureau fatiguée d’éclairer le néant.
Bien entendu, j’entendais cette sonnerie caractéristique de mon alarme interne me disant : Mec, t’es en train de faire une connerie…
Mais, pour une fois, je n’en avais rien à foutre. Ce putain de disque occupait déjà tout l’espace ! Trop à l’étroit dans sa pochette, il exigeait que je le pose sur la platine, que j’en enclenche le bras puis que je monte le son !
Je ne t’ai pas dit de tourner mollement ce bouton, je t’ai dit de monter le son ! Encore ! Voilà. À fond ! Et maintenant, écoute…
Je ne vais pas prétendre que ma vie a changé après l’écoute de cet album. Si changement il y a eu, il n’a pas été spectaculaire. Je ne me suis pas soudain senti aussi joyeusement vivant que mes contemporains. La nuit restait ce fleuve infranchissable dans lequel se débattaient au ras de la suffocation les jours pairs, les jours impairs et les jours imprécis rescapés d’un calendrier monotone. Les gens étaient toujours inapprochables de l’autre côté des murs du labyrinthe. Et mes poèmes figés sur un papier livide refusaient de parler d’autre chose que du vide.
Il y a des virus foudroyants. Ils arrivent d’on ne sait où et n’ont de cesse de ravager, de brûler, d’exterminer au maximum de leurs capacités. Attila fut de ceux-là. Le crédit à la consommation en est un autre. Et puis il y a des virus plus pépères. Qui prennent leur temps. Qui profitent du paysage. Qui massacrent bien un peu par-ci, par-là, par pur atavisme de virus mais qui semblent éprouver une forme inversée du syndrome de Stockholm vis-à-vis des corps qu’ils investissent.
Celui qui me contamina au moment où résonnèrent les premières notes de cet album était visiblement de cette dernière catégorie. Il est toujours actif et semble avoir pris son rôle très au sérieux. J’ai beau lui interdire de lire ce que j’écris par dessus mon épaule, il veille à ce que je mette un peu de couleurs sur mes phrases monochromes. Soupçonne-t-il un mot d’être encore trop à vif qu’il se faufile jusqu’à mes doigts pour tenter d’en modifier la trajectoire sur le clavier.
Nous sommes un vieux couple maintenant et nous commençons à nous ressembler. Autant je doute toujours de la pertinence de ma présence chez les humanoïdes si pressés de devenir d’infatigables machines, autant il doute de la sienne parmi les hordes d’acaryotes qui souffrent de ne pas savoir s’ils sont ou non des êtres vivants. Le seraient-ils seulement — et donc provisoirement — au moment où ils perturbent le vivant ? Le seraient-ils justement — et donc définitivement — parce qu’ils sont capables de perturber ce vivant ?
Vaste question à laquelle ni lui ni moi ne sommes capables de répondre. Peut-être parce que lui et moi ne sommes restés vivants depuis tout ce temps qu’au travers de notre mutuelle infestation ?
▣