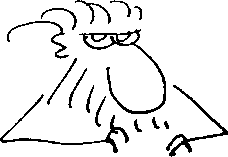Le ciel était évidemment maussade et la pluie achevait de noyer les bas-côtés du chemin dont les pièges étaient masqués par la nuit. Les routes de l’exil ne sont pas de longs cortèges de fête et Paris semblait triste de perdre l’un des siens.
La grand-place assignée aux départs se remplissait d’une foule hagarde encore ivre d’un sommeil perturbé. Le long des porches de pierres, d’énormes calèches étaient parfaitement alignées comme pour rappeler l’importance d’un ordre souverain qui ne tolérait ni la prose approximative, ni l’image atypique, comme celles qui me valaient cette levée aux aurores.
Bien sûr, la sentence s’accompagnait d’une notice spécifiant un voyage d’agrément dans un confort répondant aux normes internationales. Aussi, quand un cocher bourru au fort accent milanais nous fit signe d’embarquer dans son attelage bringuebalant, nous comprîmes d’avance la douleur des chairs qui se compriment sous le manque d’espace et de clarté.
Preuve s’il en fallait qu’il était urgent de nous voir partir d’une ville dont les retards dans les transports sont une seconde nature, les chevaux sans peur s’élancèrent à l’heure convenue en exhalant de longs soupirs grisâtres à chaque crissement de sabot sur le gravier encore froid. Le paysage défilait, silencieux. Le vent pliait les arbres, comme une ultime révérence, comme un adieu discret.
Sur la grand-route, bien avant le barrage d’octroi, de nouveaux chantiers alternaient avec les chantiers abandonnés dans un jeu de dupes et de constructions perpétuelles qui, bien sûr, ne nourrissait que ses promoteurs. D’habitude si empressés de suivre les convois, les corbeaux restaient stoïques en nous voyant passer. C’était un point positif : nous ne serions pas mangés tout de suite. Puis, peu à peu, les chantiers laissaient la place à des champs en jachère bordés de forêts qu’on imaginait sans peine repues de pendus s’agitant dans le vent pour amuser les marcassins et engraisser de leurs chairs décomposées les fougères et les mandragores.
Au lieu-dit de l’octroi, le connétable chargé de l’encaissement souleva prestement la barrière et détourna le regard. Cette fois, c’était sérieux : la route était fin prête à nous avaler en de lentes bouchées kilométriques. Il y avait encore par endroits quelques grandes échoppes endormies et à bien les considérer, elles ressemblaient à s’y méprendre à ces fleurs carnivores qui ne déploient leurs fastes qu’à l’arrivée des hordes de moucherons-consommateurs afin de leur mieux dévorer fraîches entrailles et bourses foutrement garnies.
Là où le relief de la plaine le permettait, de grands moulins squelettiques faisaient lentement tourner leurs ailes et brassaient autant de vent que mille politiciens incontrôlables. Sans qu’on sache dire combien de temps avait pu s’écouler, notre carrosse ralentit près d’une cahute isolée contre laquelle somnolaient des calèches au long cours. Son arrêt soudain provoqua la stupeur et la crainte. Mais ce n’était qu’une manœuvre de routine du cocher en second, sorti pour vérifier la tenue des harnais. Une occasion inespérée dont chacun profita pour s’alléger d’un trop-plein de cervoises. J’aurais bien pris la fuite à ce moment précis mais pour aller où ? Les alentours semblaient trop inhospitaliers. D’autant plus que de folles rumeurs y plaçaient le pays terrible des « Fangeux »…
Pour beaucoup de citadins, le pays des « Fangeux » restait un pays imaginaire censé faire peur aux enfants, aux personnes de faible constitution psychologique et aux prisonniers non repentis. Or, au détour d’un bosquet un peu plus ombrageux que ses prédécesseurs, ce pays apparut dans nos champs de vision et le découvrir subitement de bon matin restera un choc pour beaucoup d’entre nous. C’est-à-dire pour ceux qui ne s’étaient pas endormis ou qui n’étaient pas possédés par les démons luminescents de leur missel numérique. Je me demande encore si, finalement, je ne fus pas le seul à l’apercevoir.
Mais quel drôle de pays…
⁂
Sur la contre-rive la moins appentue du grand marigot ouest, derrière les buissons chétifs qui tentaient de survivre dans la fumée toxique des puits d’hydrocarbures, s’élèvaient les bâtisses misérables des « Fangeux ». Des ni-oui ni-non de cabanons tout de bois et de guingois qui ne tenaient debout qu’en étant adossés les uns aux autres, se soutenant mutuellement comme le feraient des éclopés de guerre s’extirpant d’une tranchée ou bien comme une foutue bande d’ivrognes accoudés de tous leurs membres aux aspérités du comptoir de peur que celui-ci ne s’estompe aussi rapidement qu’une trace de remords dans la conscience d’un assureur.
Dans ce dédale de masures improbables, la vétusté des abris d’infortune dictait un comportement social d’une prudence extrême où ce qui n’était pas encore interdit n’était déjà plus autorisé. Il était ainsi fortement déconseillé de claquer les portes, de hausser la voix ou de percer les murs. Les seules activités d’intérieur tolérées étaient la sieste et le sommeil à condition de ne pas ronfler et de bien digérer les haricots. Car si un seul de ces cabanons s’écroulait, c’est tout l’ensemble qui s’effondrait !
Il était évidemment interdit de faire la fête pour se réjouir d’une victoire, il est vrai fortement improbable, de l’équipe de foodball, sport dans lequel six équipes de soixante-six « Fangeux » affrontaient à tour de rôle une poignée de vers géants à l’œsophage ésotérique. Le but de chacun des protagonistes était de manger le plus d’adversaires possible en un temps choisi au hasard et annoncé au milieu de la partie. Et à ce jeu, sans beaucoup de surprise, les vers étaient souvent vainqueurs puisque avantagés par leur volume buccal qui pouvait contenir entre trois et cinq « Fangeux » de bonne taille. Du coup, ce qui était à l’origine une épreuve de courage et de bravoure pratiquée par l’élite toute relative du peuple des « Fangeux » était désormais une activité festive destinée à maintenir une certaine homogénéité dans cette population dont les équipes n’étaient constituées que de « Fangeux » incomplets ou suréquipés. Les édentés, les trijambistes, les manchots au sang chaud, les gauchers contrariés, les droitiers contrefaits, les intellectuels surmenés, les ronfleurs pathologiques et les handicapés de la digestion de haricots étaient devenues les stars incontestées de cette discipline.
À cette heure encore précoce — pas loin de douze décimes — il n’y avait pas grand monde pour se risquer au dehors. La pré-nuit, la nuit et l’après-nuit étaient le royaume des outre-chiens qui cherchaient inlassablement à sustenter du moindre rien leurs énormes mâchoires claquenaudantes. Montés sur de courtes pattes d’une vélocité prodigieuse, ils étaient capables de se manger entre eux, de se manger eux-mêmes, de se repaître d’une ombre ou de festoyer d’un « Fangeux » attardé. Les outre-chiens étaient les gardiens vociférants de ce bas-côté du monde. Un monde qui attendait de basculer dans la folie pour entamer sa nécessaire refonte. Car, ainsi que le relatait le grand grimoire gélatineux écrit dans une langue inachevée, tôt ou tard viendra la nuit la plus attendue et la plus redoutée des mille nuits du premier cycle.
La plus attendue parce que la légende la mieux traduite prétendait qu’au matin de cette nuit-là, trois soleils féconds entourés de cent mille étoiles d’or caresseront de leur chaleur les marécages du profond vide, les métamorphosant alors en une gigantesque plaine fertile engorgée de fleurs elliptiques et de fruits non fendus exhalant des fragrances dont le moins capiteux des arômes étourdira les pourtant insensibles bergers mutants pendant soixante-huit générations. Le temps nécessaire pour que leurs troupeaux bêlent et rebêlent au long des transhumances pavées de carbones intentionnels.
La plus redoutée parce que la même légende se plaît à souligner que tous n’y survivraient pas. Irradier le marais n’avait de sens qu’accompagné d’une décomposition des corps afin que l’alchimie advienne. À raison d’un corps épais par hectolitre de vase. Et de la vase, il s’en étendait depuis le ressac des montagnes jusqu’aux cicatrices actives qui bouillonnaient par delà le grand au-delà du fleuve. Autant dire que peu seraient épargnés ! Autant chez les « Fangeux » que chez leurs maîtres, les guerriers acrobates. Les outre-chiens eux-mêmes paieraient un lourd tribut mais la survie des plus féroces était par nature étroitement liée au décès nourricier — et fortement nutritif — de la grande majorité d’entre eux.
En attendant que se réalise la prophétie, les « Fangeux » passaient la plus grande partie de leur temps allongés les uns contre les autres dans le grand baraquement commun épargné par les trois dernières tempêtes souterraines, ne perdant que la moitié de son toit et l’intégralité de ses étages intérieurs qui s’entassaient désormais les uns sur les autres comme des lasagnes de briques et de bois. Bien qu’apparenté aux petits mammifères plutôt qu’aux reptiles, les « Fangeux » en panique savaient qu’ils se conduiraient comme les tortues nouvellement écloses qui traversent la plage sous l’œil gourmand des mouettes, des rapaces et des crabes. Aucun n’osait dormir de peur de louper le signal qui mettra tout le groupe en panique et lui fera traverser le territoire des outre-chiens en espérant qu’un petit groupe, cette fois, réussisse à rejoindre le grand îlot central, cet oasis enrobé d’eau claire et de clémence.
⁂
Et puis le pays des « Fangeux » disparu comme il était venu quand la pluie, soudain, s’arrêta et qu’elle emporta avec elle son décor fantastique, ne laissant qu’une illusion s’effacer progressivement comme une buée se disloque sur le verre trop lisse d’un monocle rondouillard.
Une fois bien asséchée, la grand-route se peupla de nombreuses calèches pressées de rejoindre le grand bourg dont on apercevait, au loin, les premières cheminées. Destination finale de cet étrange voyage, la ci-devant bourgade de Lugdulion et son mystère qu’il me faudra résoudre pour m’en retourner, libéré, délivré, en mes chères pénates aux abords de la Seine.
Auparavant, il fallait m’extraire des sombres quais de déchargement sur lesquels nous fûmes projetés comme des saucissons que l’on fume. Par un hasard que je pris pour de la chance, je trouvais la sortie en moins d’une demi-journée. Je reste à ce jour persuadé que certains de mes camarades de voyage y sont encore. Paix à leur âme.
Mes premiers pas dans cette nouvelle cité dont j’ignorais tout me conduisirent dans une vaillante auberge qui dut être autrefois un palace agréable et dans laquelle je profitais goulûment des quelques minutes de repos qui m’étaient accordées. Je me rendais ensuite à la Cour des Janissaires pour y être présenté — preuves à l’appui sur le grand piano droit — aux juges de céans. L’audience définitive n’ayant lieu que le lendemain on me laissa partir en m’ordonnant toutefois d’explorer la ville à la recherche de l’énigme.
C’est après avoir passé le pont de la petite rivière que la question me fut posée par celle qui marchait depuis un moment à mes côtés. Elle préleva dans sa chevelure une question validée par le vent qui s’apaisa d’un coup après m’avoir identifié comme sourd d’une oreille et mal comprenant de l’autre. « Pourquoi laisser les façades s’envoler ? » me demanda-t-elle. La question semblait simple mais il y avait sûrement un piège. Je promis d’y réfléchir et j’eus droit à une déambulation nocturne, prélude aux découvertes du lendemain.
Levé à l’aube, ce fameux lendemain, je pris la direction des antiques villégiatures. J’engrangeais force croquis et moult esquisses, m’attardant dans les ruelles, examinant minutieusement chaque façade, scrutant les cours intérieures et les devantures endormies. Déjeuner. Sieste. Puis je passai à mon cou la corde blanche frappé de l’anathème « Lutèce estoit un bourg comme tel austre » et, lentement mais sûrement, comme un condamné qui pense pouvoir narguer les balles, je me dirigeais vers le dernier verre de ma probable dernière heure.
⁂
La suite est une soirée pleine de rires et d’alcool, ce qui ne t’intéresse pas forcément. Tu espérais peut-être un compte-rendu touristique truffé de bonnes adresses et de conseils avisés. Auquel cas, tu n’es pas sur le bon site. Car plutôt qu’une chronique pour le « Guide du Routard », j’ai préféré ce guide déroutant d’un voyage somme toute extraordinaire.
Les photos sont (déjà !) disponibles sur avril 2022 – Lyon.
Et si tu te décides à suivre mes traces, profite de la vieille ville le matin en semaine, il y a beaucoup moins de monde. Trouve la clé de l’énigme et tout ira bien. Bon voyage !
▣