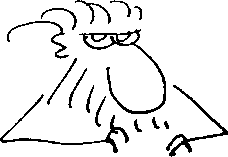Les plus anciens parmi les anciens voyageurs ferroviaires se souviennent certainement de ces jolies phrases rigolotes gravées sur une petite plaque métallique en bas de chaque vitre et prévenant les téméraires touristes italo-germano-brexitéens qu’il pouvait être dangereux de se pencher par la fenêtre du train, notamment lorsque celui-ci roulait à pleine vitesse à l’entrée d’un tunnel. Existait-il alors, cachée dans les confins d’un atelier secret, une confrérie des graveurs de « pericoloso », de « inhaus » et autre « lean » ?
Maintenant, les wagons sont climatisés et les fenêtres ne s’ouvrent plus (ou pas suffisamment pour laisser passer un corps). Ces inscriptions ont disparu, emportant avec elles la confrérie des graveurs dont la dernière œuvre fut peut-être de graver sa propre pierre tombale. C’est d’autant plus dommage qu’il existe encore des tas de fenêtres par lesquelles se pencher reste un exercice dangereux. Même si le risque désormais n’est pas tant de perdre la tête dans une fracassante collision contre un pilier de fer ou de pierre mais bien de la retrouver. Et de s’apercevoir qu’il aurait mieux valu la perdre…
Deux constats dans cet article :
- le premier — inutile en lui-même mais il sert de promontoir pour mieux se pencher sur le second ;
- le second — celui d’un corps fatigué qui n’a plus toute sa tête, certains morceaux d’icelle traînant le long de la voie, éparpillés par le choc pourtant prévisible.
Prévisible parce que préalablement indiqué. En étranger, certes, mais clairement indiqué :
« e pericoloso to inhaus lehnen au dehors de out sporgersi ! »
Premier constat
Je viens de supprimer toutes mes publications facebook. Je n’ai pas supprimé le compte. Juste les publications et les photos. Ce qui représente un peu moins d’un an de présence sur ce réseau qui est aussi social que le parti socialiste est socialiste. Constatation facile — mais sans réelle surprise : il y a assez peu d’intérêt à y être présent. Je pense d’ailleurs éliminer systématiquement ce que j’y publierais désormais, histoire de ne pas tout avoir à faire d’un seul coup car c’est extrêmement chronophage. Facebook n’a évidemment prévu aucun outil pour te faciliter cette tâche.
Ce qui m’a vraiment surpris — et quelque peu inquiété — en effaçant tout ce que j’y avais mis a été de m’apercevoir que certaines de ces publications (la plupart, en fait) m’étaient complètement sorties de l’esprit. Alors même que je les y avais mises justement parce qu’elles avaient éveillé un intérêt bien particulier. Soit pour en rire, soit pour y réfléchir.
Pour te donner un élément de comparaison — ainsi qu’une meilleure idée de ce que je suis en train de m’emmêler à t’expliquer : ce blog va bientôt entrer dans sa neuvième année. Pourtant, je me souviens absolument de chacun des articles que j’y ai écrits. À l’inverse, ce que j’ai mis sur facebook est totalement sorti de mon champ de questionnement. Comme si je m’en étais débarrassé. Peut-être, me diras-tu, devrais-je reconsidérer la fonction de ce réseau et n’y mettre que ce qui m’emmerde ou me parasite ? Ce serait trop simple.
Car malgré ses injonctions systématiques et quasi autoritaires à aimer tout et n’importe quoi, facebook est totalement avare d’empathie. D’une certaine façon, c’est plutôt une bonne chose : pas de jugement, tout est nivelé, formaté, aseptisé, plus neutre qu’un ph7 helvétique. Impossible de hiérarchiser tes propres contenus. Que tu publies une nouvelle recette de chaton au curry ou que tu essaies d’alerter sur le danger de toujours voter pour les mêmes vieilles racailles qui nous pourrissent la vie depuis plus de quarante ans, ce n’est pas à toi de décider de l’importance des informations que tu transmets. Tu transmets. Tu te contentes de nourrir la bête. Ses algorithmes assurent la digestion de tes apports. Puis leur propagation plus ou moins virale. Et au jeu de la viralité, c’est évidemment le chaton qui fait recette.
Conclusion facile : facebook n’est pas un outil pour échanger et débattre. D’ailleurs, plutôt qu’un outil, facebook est en fait un coutil, ce tissu de toile grossière, prédécesseur du blue jean, sans spécialité assignée et dans lequel se taillait aussi bien les sacs à pommes de terre que les uniformes à patates. Et pas les fines jupes plissées voletant sans effort dans le souffle douillet de la brise estivale.
Deuxième constat
Il y a quasiment un an, jour pour jour, je mettais en ligne une librairie numérique pour y publier et y vendre quelques écrits de ma savante composition. Avec l’espoir que ces publications attirent moult lectrices et quelques lecteurs mais aussi d’autres écrivains en quête d’indépendance éditoriale et de curiosité pour la chose numérique.
Douze mois et trois ouvrages publiés plus tard, le constat est tristoune : ce projet est un raté complet. (Qui a dit : « Qui se ressemble s’assemble ! » ?)
Grand merci éternel aux huit spécimens rares qui ont acheté chacun des ouvrages mais malheureusement ces ventes exceptionnelles n’ont pas permis de couvrir les frais minimaux de mise en ligne (nom de domaine, hébergement, certificat SSL). Sans compter le temps passé à bricoler tout ce foutu code qui se met rapidement à décoder sitôt qu’on le croit stabilisé et qu’alors on l’abandonne pour d’autres écrits autrement plus sexy.
Aujourd’hui, la librairie est fermée pour réparation mais j’avoue avoir du mal à me (re)motiver. « À quoi bon ? » me susurre la partie la plus feignasse de mon cerveau lent. On ne peut pas lui donner totalement tort. À quoi bon se lancer dans la reconstruction d’un paquebot pour juste emmener dix personnes faire le tour d’une île passablement aride de douze mètres de diamètre… Car malgré les efforts de certaines pour propager la bonne nouvelle, le compteur de visite est resté plus muet qu’une carpe aphone imitant le mime Marceau imitant Buster Keaton.
Les raisons de ce gigantesque échec (gigantesque au regard des attentes que j’y avais placées) sont sûrement nombreuses et certaines d’entre elles sont peut-être simplement irrationnelles. Cependant, j’en vois deux principales et qui dépendent exclusivement de moi. Sauf que je me vois mal les améliorer.
- la première — qui tient à la qualité ou à l’absence de qualité de ce que je publie sur cette librairie ;
- la seconde — qui tient à ma capacité ou à mon incapacité à faire connaître ce que j’écris avec plus ou moins de première raison.
Je ne m’attarde pas sur la première raison : qualité ou pas, je n’ai pas d’autre style à ma disposition et tout ce que j’écris (car je continue d’écrire) s’y vautre aussi complaisamment qu’un troupeau de gorets vodkaïnomanes dans la boue où se noient les pintades — et qu’il ne faut surtout pas confondre avec les pintes où se noient les boutades !
Quant à la deuxième raison…
Il ne suffit pas de remplir un formulaire pour soudain se transformer en commerçant ou en entrepreneur. Sans forcément passer par une école adéquate ou par le deal de rue, il y a quand même des capacités spécifiques à avoir. Et même si certaines peuvent s’acquérir, il y a un feeling qui semble définitivement hors de ma portée.
Quand un objet ou une collection d’objet m’encombre ou ne m’est plus utile, je donne. Pas parce que je rêve d’être une sorte de père noël mais parce que ça m’emmerde considérablement de faire de la paperasse, d’estimer une valeur, et pire que tout, de négocier des ceci ou des cela.
En fait, je veux juste écrire. Point barre. Malheureusement il y a quelques matérialités physiologiques et numériques à faire fonctionner et qui nécessitent — même a minima — quelques euros frais du jour. Alors c’est vrai que l’ébauche d’embryon d’une possibilité de vivre de son écriture était terriblement enthousiasmante : tu écris, les gens achètent, tu vas boire des bières, tu écris, etc, etc… Ad vitam et sans avoir à te prostituer pour un éditeur ou un distributeur !
Comme il est toujours hors de question que j’en arrive à de telles bassesses, il ne me reste que deux possibilités, donc trois :
- la première — qui pourrait prendre la forme d’un abonnement sur une plateforme ressemblant vaguement à ce que je souhaitais faire et sur laquelle je ne serais qu’un item parmi d’autres mais pour laquelle je n’aurais pas à rester tardivement éveillé afin de la rendre fonctionnelle ;
- la seconde — qui voudrait que je me remette illico au travail tant qu’il me reste quelques neurones actifs et quand même pas mal de matériel à récupérer sur la première mouture ;
- la troisième — qui serait donc un amalgame des deux premières : trouver une plateforme de publication (j’en ai une — anglophone — à examiner dans le détail) et profiter du temps que ça me laisserait pour apprendre sérieusement à coder.
La troisième solution étant la plus raisonnable, c’est aussi celle qui a le moins de chance d’aboutir. Tu me connais ? Si j’étais de nature raisonnable, je ne serais pas là en train d’échafauder des plans foireux mais quelque part sur une plage à corriger quelques chapitres entre deux mojitos géants et trois naïades étincelantes dont les pagnes multicolores en fine dentelle ajourée voletteraient sans effort dans le souffle douillet de la brise estivale…
Bref, en attendant que je me décide à rejouer « à la marchande » — et si tu ne t’étais pas encore procuré les trois vilains petits canards précédemment publiés — laisse moi ton mail et je te les expédie en retour. Gratuitement.
Oui je sais : le PIB, la croissance, tout ça… Rien à battre. Si vraiment tu as des sous en trop, refile-les à un barman dans le besoin. Et bois une bière à ma santé.
▣