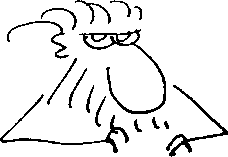Les sujets de philosophie du baccalauréat 2024 sont tombés et parmi ceux-ci, ces deux-là :
- La science peut-elle satisfaire notre besoin de vérité ?
- L’État nous doit-il quelque chose ?
Je ne vais évidemment pas te faire une dissertation scolaire et ce que tu vas lire ci-dessous — si toutefois tu le lis — m’aurait certainement valu un beau zéro.
Mais.
Selon ma longue expérience de philosophe de comptoir, ces deux sujets n’en font qu’un. D’une part, la science — activité collective par essence — a nécessairement besoin qu’un État en organise et en régule les complexes imbrications et, d’autre part, si l’État nous doit quelque chose, c’est, en premier lieu, la vérité.
Bien.
Maintenant, il faut développer un peu tout cela.
D’abord, comme dans tout exercice d’explication, il y a des définitions à apporter. Ici, il faut définir au moins trois entités : État, science et vérité.
On peut aussi remarquer qu’en dehors du contexte d’État, il est impossible de parler de science ou de vérité. Car bien que la science est moins subjective que la vérité, ces deux concepts ont pour raison d’être de permettre, aux côtés de la culture et de l’agriculture, la continuité temporelle dudit État. C’est pourquoi il faut commencer par définir ce qu’est un État.
Les étudiant.es qui planchent sur ces sujets n’ont pas le droit de consulter un dictionnaire ou Wikipédia. Moi, oui. Ce qui est une forme de triche et justifie donc le zéro pointé au début de ce texte. Et puisque tu peux, toi aussi, vérifier tout cela de ton propre chef (d’état), je vais m’en tenir à des définition très généralistes.
Un État (avec une majuscule) est un ensemble immatériel constitué d’un territoire physique habité par des groupes d’êtres humains. Cet ensemble définit les lois qui régissent la vie des habitants de ce territoire. Autrement dit, l’État est un concept purement humanoïde (comme l’est certainement la notion même de concept). Il n’y a pas d’État sans population humaine et il n’y a pas de loi s’il n’y a personne pour la rédiger, l’appliquer, la respecter ou la détourner. Cela paraît évident aujourd’hui mais les siècles précédents ont vu une abondante littérature disserter sur cette question avec des opinions fort différentes et parfois opposées.
À noter : il ne faut pas confondre l’État et le gouvernement non plus que l’État et la nation, l’État et la population ou l’État et le territoire. Il y a bien sûr de nombreuses passerelles mais l’État est essentiellement la représentation immatérielle et intemporelle de l’ensemble de ces composants auxquels on peut ajouter de façon plus ou moins pérenne la citoyenneté, la représentation, la langue, les institutions, la littérature, l’art en général, les activités, les traditions, l’Histoire, la cuisine (sauf pour l’État grand breton), l’humour, l’amour, l’armure, l’armoirie et le remord plus ou moins sincère des exactions passées.
Voilà pour l’État.
Mais dans quel état est la science ?
La science, au premier abord, est plus simple, non pas à comprendre mais à définir. Il s’agit d’un ensemble d’expérimentations et de procédés normalisés qui permettent d’obtenir un résultat toujours identique si les conditions des ces procédés et de ces expérimentations sont identiques. Dans un contexte scientifique idéal, une même cause produira toujours le même effet. Et cela doit être corroboré par plusieurs équipes dans le but d’en ôter toute partialité ou toute erreur de manipulation.
Ces expérimentations sont parfois le fruit du hasard mais, le plus souvent, elles sont issues d’une tentative de reproduction de phénomènes naturels. D’abord foutraques, sauvages, aléatoires, non concluantes, ces expérimentations ont fini par être canalisées grâce à l’utilisation concertée d’outils intellectuels comme les mathématiques ou la philosophie, tant pour assurer le développement cohérent de ses multiples séquences que pour tenter d’en appréhender les innombrables conséquences.
Ces outils intellectuels ne poussent pas sur les arbres. Il a fallu les penser et les affiner au fur et à mesure que les expérimentations prenaient de l’ampleur. Il a fallu les façonner pour les rendre quasi universels afin de pouvoir les utiliser et les enseigner.
Pour développer ces outils et les enseigner, les groupes humains ont nécessairement eu l’obligation de s’organiser de manière plus ou moins rationnelle et surtout durable. La science (le désir de science) n’est peut-être pas directement à l’origine de la naissance de l’État mais elle en est très certainement un des organes majeurs.
Comprendre le monde, anticiper les catastrophes, réarranger le vivant à son profit exclusif, l’humanité est une espèce technologique donc scientifique. Et aucune technologie d’envergure ne peut être développée de manière pérenne par une personne seule. Il est nécessaire que plusieurs groupes s’organisent pour conserver les savoirs anciens, échanger et transmettre les savoirs du présent, penser et préparer les savoirs du futur.
La science est d’abord une cartographie de la connaissance et cette cartographie nécessite d’être sans cesse remise à jour. Plus que les lois qui peuvent être conjoncturelles puis obsolètes, la science est un parcours cohérent, balisé, reproductible. C’est à la fois un musée, un atelier et un laboratoire dont l’unique objet est la connaissance.
Mais cette connaissance est-elle la vérité ?
C’est la partie la plus difficile à définir. Et malgré tous les progrès scientifiques et législatifs dont est capable l’humanité, ses différentes sociétés sont encore déchirées par des croyances contradictoires et des allégations alternatives qui mettent souvent à mal les notions même de science et de loi, donc d’État.
Le problème de la vérité est qu’elle est multiple. Et qu’elle se cache. Peut-être est-elle inexistante ? Mais elle éclaire le chemin tout autant qu’elle y dissimule des pièges. Elle dit oui aux uns et non aux autres. Elle se désagrège plus vite qu’elle ne s’envisage. Il lui arrive même de mentir. La raison est intrinsèque à la notion même d’humanité : la vérité est un rêve, un but, un idéal, une mission mais aussi un paradoxe, un leurre, une chimère. Elle doit toujours être cherchée mais ne doit jamais être trouvée. Car c’est cette recherche qui est la clef du progrès. Tant social que technologique.
Bien sûr, et le monde actuel en est une preuve flagrante, cette recherche peut être mal orientée, peu documentée et surtout assez peu remise en cause.
Or.
La recherche de la vérité n’est pas un chemin tracé d’avance et seulement connu par quelques prophètes ou gourous en mal de gloire. C’est un réseau inextricable de chemins qui s’entrecroisent et qu’il faut parcourir intégralement dans un sens puis dans l’autre.
Il faut se tromper. Il faut se perdre. Il faut douter. Il faut recommencer. Il faut parfois (souvent) faire marche arrière. Il faut essayer autrement. Il faut se souvenir. Il faut partager. Il faut laisser l’imagination jouer son rôle de guide. Il faut s’arrêter et contempler les arbres, les ornières et tout ce qui rend chaque chemin absolument unique et nécessaire.
Chaque chemin doit ressembler à cette route.
Et chaque route doit connaître la déroute pour mieux s’ouvrir sur une nouvelle route. Ou une plus ancienne qui sera alors revisitée sous un autre angle.
Ainsi, plus que la vérité, l’État nous doit le libre accès aux chemins qui y conduisent. La science est un de ces accès. Mais ni l’État, ni la science ne sont la vérité car la vérité n’est ni scientifique, ni statutaire.
Quiconque affirme l’inverse est un menteur. Un écrivain. Un religieux. Pire : un politicien.
▣