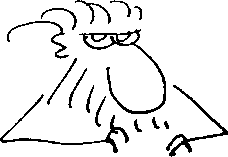Prends ton cahier et dessine ce que tu veux puisque le dessin est l’art ultime. Il constitue l’ADN de tous les autres. Sans dessin, pas de peinture, de sculpture, de bande dessinée. Pas de danse. Ni littérature, ni théâtre : l’écriture est enfant du dessin. La musique est à part, elle est au-dessus des arts et au-dessus de la vie mais ça reste complexe à expliquer…
Et puis ça laissera le temps à ce texte de trouver la route la plus adéquate une fois que sera achevée la phase de négociation stylistique entre courbes narratives en contre-dévers acrobatiques et glissades sémantiques tout aussi impromptues que malhabiles, les deux étant de toute façon fortement réprimées par les contextualisateurs soporifiques qui règnent à présent sur le monde vieillissant des lettres. Et si je commence à m’égarer dès le premier virage, on n’est pas rendu… Mais c’est aussi le charme des routes anciennes et de leur balisage discret : proposer des directions imprécises ornées de bas-côtés fertiles en faune sauvage et en flore indigène. Ralentir la course pour allonger le voyage.
Le mot « route » est un mot essentiel dans toutes les langues. Peut-être est-il le fondateur des langues ? Peut-être a-t-il accéléré — voire nécessité — la mise au point du langage articulé afin d’en appréhender au mieux tous les contextes ? N’oublions pas que l’humanité est une espèce nomade. Même si ça paraît moins évident aujourd’hui tant la racaille capitaliste s’est ingéniée — et a quasiment réussi— à nous rendre définitivement sédentaires pour mieux se repaître de nos faiblesses qu’elle sait parfaitement transformer en promotions du jour ! Mais de base, il y a quelques centaines de milliers d’années, nos ancêtres étaient constamment en mouvement, que ce soit pour occuper de nouveaux espaces au gré des agrandissements familiaux, pour changer de campement éphémère, pour chercher d’autres territoires de chasse ou plus pragmatiquement pour échapper aux divers dangers de cette lointaine époque, lesquels dangers — bien qu’ils pouvaient parfois être à dents de sabre ou à éruption incandescente et spontanée — ne présentaient pourtant guère plus de nocivité que le mensonge patriarcal, fournisseur exclusif de calamités, gros, demi-gros, détail, religion, monétisation, télévision, travail, famille, patrie, etc.
De ce fait, le souvenir — subliminal mais impérissable — de ces voyages incessants est aujourd’hui matérialisé par le concept de route. Autant par ses nombreux avatars physiques : ruelle, sentier, chemin, boulevard, rail, autoroute… que par ses entités poétiques au kilométrage inconstant : du long voyage d’Ulysse au petit poème qui a permis la mise en route de ce texte.
Le poème en question — que je ne connaissais pas — date de 1916. Oui, tu as bien lu : mille neuf cent seize ! Soit — coïncidence ? — la même année que l’insurrection de Pâques qui voit l’Irlande hésiter entre deux routes dans sa rebellion contre l’autorité britannique. Le poème, œuvre de Robert Frost, poète états-unien du début du xxe siècle, est un poème emblématique. L’est-il parce qu’il parvient à réduire l’éternelle question du choix à la la simple matérialité de l’objet du choix ? Avant toute autre considération, la route conditionnerait-elle le choix ?
Pas si simple. Ou pas si tordu, comme tu préfères.
De par son histoire récente, la culture invasive nord-américaine s’est entièrement construite par et pour la route. Je précise « culture invasive » par opposition à la culture indigène qui existait avant l’arrivée du suprémacisme européen. Cette culture invasive a institué le cheval puis la voiture — intermédiaires essentiels entre l’être humain et la route — comme de nouveaux dieux intouchables. Cette culture de la route ne sert pourtant, au mieux, qu’à célébrer la quête de la liberté individuelle. Au pire, à ne pas reconnaître cette quête comme une impasse, l’impasse étant la négation absolue du concept de route. Car des routes, les états-uniens en ont mis de partout. Des centres-ville à l’espace intersidéral ! Ils en ont farci leur cinéma, leurs comics et leur littérature. Jusqu’aux réseaux informatiques qui n’existeraient pas sans routeurs. Sans oublier le rock’n’roll dont l’épitaphe et la raison d’être peuvent tenir en quatre petits mots.
J’ai reçu ce poème comme cadeau par une amie bien intentionnée au point que certains la voient comme la dernière des fées. Elle n’est peut-être pas la dernière, mais elle est assurément une fée. Problème, je l’ai reçu en anglais. Car les fées sont cosmopolites.
Or.
Si je suis capable de rapidement comprendre un texte simple (par exemple : Yes, all the beers are free, you’re welcome!
), la poésie — y compris en ma langue natale — demande un surplus d’attention.
Afin que tu te fasses ta propre idée sur ce poème — et parce que je n’ai pas envie de le retranscrire ici — je te laisse le découvrir tel que me l’a livré la fée : The Road Not Taken.
Tu ne perdras rien en écoutant simultanément cette autre histoire de route par Calvin Russell, cet autre poète états-unien. Et s’il te reste un peu de temps pour découvrir les routes improbables et changeantes de l’illusion poétique, en quelque langue que ce soit, assieds-toi, range ton cahier et lis ce qui suis.
Il y a trois façons de lire un poème.
Tu peux le lire littéralement, tel qu’il est écrit et n’en comprendre que le sens alphabétique. Ce qui reviendrait presque à lire une communication gouvernementale censée t’expliquer le meilleur moyen d’enrayer une pandémie. La seule différence étant qu’une communication gouvernementale n’a même pas de sens alphabétique.
Tu peux alors préférer le lire tel que le poète l’a pensé pour tenter d’en comprendre toutes les subtilités. Mais le poète lui-même sait-il vraiment ce qu’il écrit ? Souvent, l’inspiration est une giclée de sang chaud qui s’affadit en séchant sur le papier.
Tu n’a donc plus qu’un choix : le lire tel que tu l’aurais écrit. Et en ce qui me concerne, ce poème je l’aurais d’abord écrit en français.
Dont acte.
J’ai rechaussé mes lunettes de traducteur intérimaire (exemple sur ce texte) et j’ai mis en œuvre plusieurs copies correspondant chacune à une hypothèse. Car sous son apparente simplicité de promenade sylvestre, ce poème cache des complexités imbriquées et tend ses pièges stylistiques à qui croit se l’approprier.
Traduire un texte en prose comme celui référencé au paragraphe précédent demande évidemment d’en bien comprendre le sens mais aussi de travailler sa proximité spatiale et temporelle avec les protagonistes du récit. Par chance, ce texte sur l’esclavage était contemporain de ma propre époque. Il me restait à revoir la géographie des Philippines et à ne pas tomber dans les pièges de la traduction littérale.
Traduire un poème, pourtant beaucoup plus court, est un tout autre défi. Outre la compréhension globale du texte, la question centrale est : faut-il, d’une part, respecter la forme du poème et, d’autre part, rester au plus près du vocabulaire d’origine ?
Je sais bien que tu as fait l’effort d’aller le lire mais je te rappelle que celui-ci contient quatre strophes de cinq vers chacune dont les rimes suivent un rythme en a-b-a-a-b. J’ai respecté ces deux aspects. Par contre, après moult essais peu concluants, j’ai décidé de reconstruire certaines phrases et de me reposer sur l’alexandrin, matériau sûr qui se conjugue bien à la musicalité du français. De toute façon, l’auteur ne viendra pas se plaindre.
Je t’épargne les versions intermédiaires que j’ai renvoyées à leur triste sort d’ébauches interminables — dont une version vraiment trop scabreuse — et je te confie ma version de ce poème.
Deux routes se séparaient dans une forêt d’automne.
Ne pouvant voyager sur les deux à la fois
je restais là longtemps, indécis et aphone,
regardant la première se perdre sous les aulnes
aussi loin que ma vue transperçait le sous-bois.
Puis je pris la deuxième, pour tout dire sans détour,
car elle me paraissait plus précise dans sa fuite,
parsemée d’herbes folles invitant au parcours,
bien qu’avant mon passage, et très sûrement ensuite,
ces deux routes s’éclairaient du même contre-jour.
Deux routes ce matin à portée de ma main,
Vierges de tout passage sur leur tapis de feuilles.
Et si j’ai bien pensé revenir dès demain,
je sais trop qu’une route est faite d’autres routes.
Et de l’une désormais je dois porter le deuil.
Je le dirai plus tard, en un soupir hanté,
il y a loin et longtemps, au vrai, quelle importance ?
deux routes divergeaient dans un bois de futaies,
et celle que je pris fut la moins fréquentée.
Voilà ce qui a fait toute la différence.
[Robert Frost 1916, trad. décembre 2020, ériic jii]
Prétendre que je suis satisfait de cette traduction serait mentir. Il me semble que cette version (en français) manque du double sens (peut-être involontaire ?) qui transparaît dans la version anglaise.
Ce qui amène quand même un certain nombre de questions ainsi qu’un certain nombre de réponses mais en quantité très certainement moindre car même s’il peut y avoir plusieurs réponses par question, certaines questions sont bien sûr sans réponse. Sans même évoquer les quelques réponses sans question. Du coup, si on y ajoute l’âge du capitaine en pourcentage global non compensé par un quelconque indice arbitraire qui change de toute façon trop souvent pour être parfaitement fiable, alors, sauf erreur de ta part, normalement le compte est bon. Je te laisse vérifier, j’ai autre chose à faire.
Déjà, le titre est étonnant puisque c’est la route non prise qui est mise à l’honneur. Regret ? Provocation ? Ellipse ?
Même si la route empruntée l’est de façon un peu aléatoire, on aurait pu s’attendre à ce qu’elle soit le sujet principal du poème. Mettre l’accent sur l’autre route est peut-être aussi une façon de détourner les promeneurs de la route « la moins fréquentée » afin qu’elle le reste. C’est alors une forme de préservation. Et de fierté si on considère comme positive la valorisation de « toute la différence » qui conclue le poème et lui donne ainsi sa raison d’être.
Tu la vois venir gros comme un camion américain la métaphore du choix et de ses conséquences. Avec comme arrière-plan l’acceptation des conséquences de ce choix, non pas comme une fatalité : (« d’façon, on peut pas rev’nir en arrière, alors… »), mais comme un remerciement enjoué envers le hasard qui a opéré ce choix.
Pour résumer.
Le gars, il se balade dans les bois et à un moment, il doit choisir de prendre soit à gauche soit à droite avec comme seul critère de choix son inspiration du moment. Notons qu’il aurait pu ne pas choisir, faire demi-tour et rentrer chez lui. Mais il a un poème à écrire. Il fait son choix mais ne dis pas vraiment lequel. Les indices sont insuffisants. Le premier, celui qu’il ne prend pas, est-il celui de droite ou de gauche ? Ce qu’on peut deviner, en revanche, c’est qu’aucun des deux chemins n’étaient connus de lui. Sinon, il n’aurait pas hésité si longtemps et ses critères de choix aurait été plus précis. Si je prends à droite, je risque de rencontrer le vieux Bob qui va encore me prendre la tête avec son arthrose. Si je prends de l’autre côté, je vais sûrement croisé la jolie Dolly. Franchement, j’hésite…
C’est ici que la personne qui lit ce poème se voit contrainte de plonger dans sa propre boîte à métaphores pour tenter de donner un sens à cette promenade. Avec toujours la même conclusion: à partir du moment où la marche arrière est impossible, le choix de départ est forcément le bon et tout ce qui découle de ce choix doit être accueilli sinon avec un inextinguible ravissement, au moins avec un pessimisme réduit à sa portion la plus congrue, d’une taille à peine inférieure à la couche d’empathie sociale d’un banquier d’affaires.
Dans un pareil cas, les métaphores les plus courantes iront de l’éternel clivage entre classicisme et modernisme jusqu’au dilemme cornélien qui t’oblige à choisir entre fromage et dessert. Entre ces deux extrêmes, je te laisse imaginer d’autres exemples de choix qui ne te seront ni repris ni remboursés.
Pour ma part, je vois dans ce poème une allégorie de ma propre philosophie de vie. Ne rien regretter. Jamais. Pas de rétroviseur. Ce qui ne veut pas dire oublier. Juste intégrer. Intégrer et assumer. Puis continuer d’avancer. Pas le choix puisque la vie ne t’offrira jamais le moindre retour en arrière. Une route, une autre, encore une autre. Et lorsqu’il n’y a plus de route à prendre, ce n’est pas parce que les ouvriers du génie civil sont en grève. C’est simplement que ton voyage s’arrête là.
Bien sûr, tu ne peux pas dresser par avance un plan de toutes ces routes. La surprise est la règle. Par contre, lorsque les routes se séparent, tu n’es pas obligée de toujours choisir l’axe de plus grande circulation. Il existe des sentiers qui ressemblent à peine à des passages et qui regorgent de fougères, de framboises et d’oiseaux. Il y a des chemins pierreux qui s’avèrent plus roulants que des asphaltes lisses. Les raidillons étroits et les venelles pentues m’ont toujours, au final, plus satisfait que les larges avenues rectilignes bordées de néons tristes.
De fait, il ne faut pas attendre grand chose du choix ou du non-choix d’une route. Celle-ci, une autre, peu importe. D’autant que les routes ont aussi leurs chemins de traverses tapis dans l’ombre d’un regard ou dans le phrasé d’une conversation anodine. C’est impossible à vérifier mais peut-être que certaines routes bouclent et te ramènent finalement sur cette route non prise…
J’ai l’âge pour commencer à discerner ces fameux chemins de traverse, tous ces embranchements secondaires parfois boueux auxquels on ne prête qu’une attention éphémère. Ce sont pourtant eux qui façonnent le véritable tracé de ta vie. Ils ne sont pas photogéniques — un plus jeune écrirait qu’ils ne sont pas instagrammables. Ils s’oublient, se confondent, s’éparpillent puis se perdent dans nos mémoires ingrates. Un peu comme sur ces cartes routières qui ne colorient que les axes principaux et rassemblent en un seul trait noir, fin et anonyme, le reste du réseau.
Rendre un hommage discret aux oubliés de la cartographie est sans doute la véritable élégance de ce poème et la raison de sa popularité.
▣