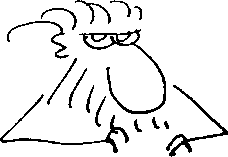Le nombre 40 est un nombre apparemment inoffensif. Personne n’a jamais été agressé par un nombre 40 sorti de nulle part pour étancher sa soif de sang frais. Par exemple, en France, le département numéroté 40 est attribué aux Landes qui est la région la…
Le téléphone n’est pas un bijou de confiance
Un téléphone portable, c’est un peu comme un être vivant : en apercevoir les entrailles, ce n’est pas très bon signe. Le mien est donc en train d’agoniser lentement, ce qui m’agace prodigieusement car je vais devoir en acquérir un nouveau. Et s’il…
Les douze péchés capitalistes
« Dry January ». Encore une idée stupide sortie tout droit d’un bureau marketing au service du lobby de l’alcool. Car il est évident que les adeptes de cette supercherie sont de gros consommateurs qui compenseront très largement les mois suivants. Dommage. Car l’idée…
La peur de l’eau
C’est le genre de signe qui te montre à quel point tu as vieilli. C’est l’instant où tu comprends que ton monde d’avant n’est plus qu’une fumée translucide qui se confond avec le brouillard de l’oubli. C’est comme un acte désespéré qui…