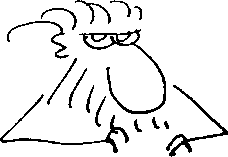« Les histoires d’a
Les histoires d’a
Les histoires d’amour finissent mal
En général »
Rita Mitsuko
Quand on pense chagrin d’amour, on pense qu’il y a d’un côté un « bourreau » et de l’autre une « victime ». Or il n’y a ni l’un, ni l’autre. Parfois, il n’y a même ni chagrin, ni amour.
Ce texte est écrit sans beaucoup de préparation — ni peut-être beaucoup de cohérence — car il explose sous le coup d’une colère trop longtemps rentrée : celle de constater que certains êtres humains sont toujours des bipèdes pourvus d’une faiblesse psychologique abyssale ! Et puis cela fait longtemps que je me retiens de mettre tout ça en mots parce que je crois — parce que je sais ! — qu’on a mieux à faire que se lamenter sur les conséquences de ruptures qui ne sont finalement que des crises d’égo, des poussées de narcissisme ou des tentatives de broyer autrui pour éviter de regarder en face un troublant besoin de scarification.
Mais écrire, ça fait du bien. Au moins pour celle ou celui qui écrit.
Tu comprendras très vite qu’ici je m’en prends principalement à la « victime » auto-déclarée, cette personne qui prétend qu’une autre vie lui appartient parce qu’un beau jour — ou peut-être une nuit — cette vie l’a regardée, lui a souri et lui a offert ce « plus si affinités » qui ne devrait jamais être conçu comme une dette. L’autre, le soi-disant « bourreau », n’est bourreau que de son propre cœur et a juste besoin qu’on lui foute la paix !
Et parce qu’on a toutes et tous été, parce que nous sommes ou serons l’un ou l’autre (tantôt le « bourreau », tantôt la « victime »), il faut lire ça posément — moins vite que je ne l’ai rédigé — et redémarrer sa vie sans plus jamais forcer autrui à y prendre part contre son gré.
Petite note pour les habituées de ma prose ordinaire : contrairement à ce que je tente de faire dans mes autres textes, j’ai, cette fois, privilégié un interlocuteur masculin. Je l’ai fait par commodité d’écriture, parce qu’il est tard et que je souhaite finir avant la fin du couvre-feu matinal. Mais les ruptures n’ont pas de genre autre que grammatical. Les femmes comme les hommes tombent vite dans l’excès de larmes et l’abus de complaintes lorsque leur vie négocie difficilement un virage un peu abrupt — voire quand cette vie rate ledit virage et se vautre lamentablement dans les marécages vénéneux où stagnent, satisfaits et vindicatifs, la suffisance de soi et l’inattention à l’autre. Dans ce qui suit, tu peux t’amuser à remplacer les « ils » par des « elles », donner des ailes aux îles et changer les décilitres de bile par de joyeux décibels, ça ne modifiera pas grand chose au propos.
Fin de la petite note et fin également — quelle coïncidence ! — de l’introduction. Comme souvent, j’ai tendance à faire de très longues introductions au point qu’il m’arrive de ne plus savoir quoi ajouter dans le cœur du texte. Je te souhaite que ce ne soit pas le cas cette fois-ci…
*
Confrontés à un chagrin d’amour, la plupart des mâles s’avèrent inconsolables. Ils se sentent trahis, perdus, abandonnés. Tout simplement parce qu’ils ont appris très tôt à se comporter en conquérants, en décideurs. Du coup, une rupture qui n’est pas de leur fait est vécue non seulement comme un immense échec personnel mais également comme une faille inattendue et inacceptable dans un système de références ou tout n’est que comparaison et compétition.
Le refus, l’incompréhension, le déni, la manipulation sont ce qui apparaît assez vite dès lors que l’autre maillon a rompu la chaîne. S’y ajoutent très souvent la jalousie, le repli sur soi, l’absence d’empathie, le rejet des fautes, la peur du discrédit social avec, en prime, quelques apparitions en « guest star » du complexe d’infériorité accompagné de son fidèle écuyer, le complexe de persécution. Du lourd. Du pénible.
Pour autant, il ne faut pas négliger la réalité de la douleur causée par une rupture. Encore moins la nier. Cette douleur existe, elle est indéniable. Mais elle est interne et doit le rester.
Une idylle est un « Doctor Feelgood » et la douleur concomitante est son « Mister Hyde ». Car l’idylle et la douleur sont des sœurs jumelles. En temps normal, tant que l’idylle suit son cours, la douleur est tapie, silencieuse. Elle attend son heure. Et si l’idylle aime voler au plus près du soleil, la douleur est comme une faille intrinsèque qui révèle plus qu’elle ne détruit. À condition de prendre le temps de la lire comme on prend le temps de vivre son idylle. D’en avoir la volonté, surtout. De comprendre que la douleur est un astre souterrain qui ne devrait pas s’échapper et venir polluer ce qui est hors de son domaine réservé, à savoir la personne d’où elle sourd.
Transmettre une douleur ne l’atténue pas. Aucune déception amoureuse, si profonde soit-elle, ne devrait se comporter comme un site industriel irresponsable qui déverse ses rejets toxiques dans la rivière en contrebas en prétextant pour sa défense que cette rivière coule trop près, ou trop loin, qu’elle n’est pas assez large, qu’elle n’a pas assez de débit, qu’elle préfère couver poissons et amphibiens rares plutôt que se comporter en collecteur d’égouts, qu’elle est allée s’abandonner, lascive et impatiente, dans les bras d’un fleuve en aval ou bien qu’elle a plongé dans l’océan pour s’alléger d’un poids, se nettoyer des bribes exogènes qui l’ont rendue boueuse.
C’est là qu’il convient de parler d’une erreur de perception majeure et largement entretenue : croire que le bonheur et l’amour sont synonymes. Qu’ils sont liés au point que le bonheur nécessite l’amour et que l’amour déclenche le bonheur. Qu’ils sont si intimement appairés qu’il est forcément impossible de les distinguer.
Or.
« Il n’y a pas d’amour heureux. » écrivait Aragon. Et pour cause ! L’amour et le bonheur sont deux notions très différentes. Deux parcours totalement indépendants. Ils peuvent bien sûr donner l’impression de se croiser, de cheminer ensemble, de décider l’un pour l’autre. Mais ils ne sont pas apparentés comme peuvent l’être, par exemple, la faim et l’appétit. Ils ne sont pas aussi dissemblables que le jour et la nuit — ils ne sont pas opposés — mais ils ne sont pas liés. Ils paraissent complémentaires parce que la culture au sens large les a enrôlés et figés dans des postures de dépendance. Des antiques tragédies grecques au romances filmées d’aujourd’hui, partout, lorsque l’amour n’est plus alors le bonheur s’enfuit et cède sa place aux pleurs, aux jérémiades, aux chantages, aux harcèlements, aux violences…
La réalité, comme toute réalité, est évidemment plus simple. Elle est donc moins acceptable. Notamment pour les systèmes de domination sociale axés sur le contrôle des émotions. Problème : l’amour est un fournisseur d’émotions fortes. Trop fortes. Il faut alors le compenser par des émotions plus douces, plus graduelles. Le patriarcat, le capitalisme et la religion (qui sont une seule et même calamité) ont bien compris l’intérêt de relier l’amour au bonheur. Sur cette alliance surréaliste est née l’idée du couple et du mariage, idée qui nous encombre encore aujourd’hui — pour le meilleur et pour le pire !
Mais l’amour et le bonheur ne sont pas du même espace-temps. L’amour, bien qu’immatériel, triture les corps et emmène la chair en des confins autrement inatteignables. Le bonheur, plus posé, plus terre à terre, ne vise qu’à tranquilliser l’esprit. Et l’entrelacement confus de leurs interactions rendent celles-ci tout aussi ambiguës que manipulables.
Plus précisément.
L’amour est une transgression. Une liberté fugitive imperméable à toute contrainte. Il va, il vient, il repart, il revient, il disparaît… pour mieux — ou ne jamais — réapparaître ! L’amour n’a pas d’échelle de temps, ne parcourt aucune distance et n’occupe aucun espace. Ce n’est qu’une série d’implosions capable de mettre instantanément en ébullition la plus épaisse des carcasses endormies ! Et d’y laisser de profondes entailles à jamais rougeoyantes.
Le bonheur est un ailleurs. C’est une destination lente. Un horizon proche. C’est une île de terre et de pierre qui ne figure sur aucune carte mais vers laquelle converge toutes les boussoles. On peut s’y trouver ou s’en éloigner sans s’en apercevoir. Cette notion de voyage est souvent négligée quand on évoque le bonheur. C’est pourtant sa fonction première. Il n’y a pas de bonheur immobile.
Il ressort de tout ça que l’amour est une capacité interne. Cette capacité est fondamentalement et strictement lié à un individu. Elle fait partie de son unicité au même titre — mais pour d’autres raisons et d’autres objectifs — que son ADN et sa psychologie. Aucun amour ne ressemble à un autre. Aucun n’est divisible ou échangeable.
Si l’amour est complexe, obéissant à des arcanes aléatoires qui mêlent biochimie et spiritualité en une inextricable pelote sensorielle, le bonheur, lui, est traçable. Voire tracé. Le bonheur est une possibilité. Une option. Ce n’est pas une décision aventureuse. C’est une suite de pas qui dessine un chemin familier bordé d’une jungle paisible. Le bonheur peut se vivre seul ou à plusieurs. Il se construit comme une maison. Brique après brique. En prenant soin d’y percer des portes et des fenêtres. En laissant la glycine s’y suspendre et fleurir au printemps. Le bonheur est une matière malléable et facile à travailler. Et le bonheur des uns peut parfaitement faire le bonheur des autres. Un ami, un parent, un inconnu rencontré par hasard peuvent y mettre en commun leurs joies, leurs sourires, et y partager des moments d’une infinie tendresse que même l’orage ne perturbera pas.
Le bonheur est un choix. Presque un atavisme. En revanche, on ne choisit pas de tomber amoureux. On n’a pas d’autre choix que de laisser son corps fondre lorsque ses molécules tentent de réinventer l’univers à la suite d’un Big Bang aussi aléatoire qu’inattendu. On ne choisit pas non plus de ne plus être aimé. De contempler, impuissant, un soleil qui s’éteint. D’imaginer sa propre galaxie devenir la proie d’un nuage d’antimatière annonçant la fin des passions. Mais on peut faire le choix de ne pas se morfondre !
Oui, ça fait mal ! Et alors ?
La douleur est toujours un indicateur, un panneau informant d’une fausse route. C’est au conducteur de lire ce panneau. De l’interpréter et d’agir en conséquence au lieu d’engueuler son passager ou sa passagère !
Je n’en peux plus de ces insensibles qui s’imaginent que l’univers a été créé pour simplement leur chier dans les bottes ! Qui se croient seuls et seules affublées d’une croix faite d’enclumes et de poix ! Si l’autre est parti, il y a de bonnes raisons à cela. Bonnes ou pas, d’ailleurs, peu importe. Le mot important est parti. Fini. Over. Terminé. On est seul responsable de sa douleur quand une histoire prend fin.
L’enfer, c’est nous autres !
On veut toujours que le monde nous ressemble. On exige des autres qu’ils se servent de nos yeux, de notre odorat, de notre intelligence pour décrire ce qui nous entoure. On rêve d’une démocratie qui n’aurait que nos lois. On veut des DJ’s qui ne passeraient que nos playlists ! On oublie facilement que notre nombril n’est pas le modèle absolu autour duquel s’est bâti le monde. On refuse de voir que ledit monde est une source infinie de nombrils bien plus intéressants car toujours renouvelés.
Tu as kiffé ton idylle ? Alors aime ta douleur car elle en est la validation, la signature infalsifiable. La douleur n’est pas qu’une fin. C’est aussi une faim. Et c’est déjà le début de ta prochaine histoire.
▣