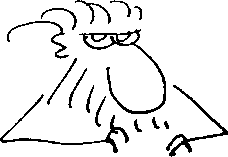Deux images qui disent la même chose. Deux images prises à quelques heures d’écart par deux personnes différentes dans deux régions distinctes. On peut appeler ça de la communion d’esprit. Il y en a. C’est plus sûrement un message subliminal adressé au monde : « Foutez-nous la paix ! ».
Ces deux images offrent un panorama dans lequel se lit le besoin de respirer. Le besoin d’espace. Le besoin de voir loin. Il ne s’agit pas non plus de s’échapper définitivement, de faire table rase, de tout réapprendre de zéro. Ces images ne représentent pas un désert à partir duquel renaître. Le quotidien et ses tracas y est présent. Il y a des maisons sur l’une, des éoliennes sur l’autre. Et on peut facilement y voir la représentation symbolique des deux facettes du quotidien : le personnel et le professionnel. Mais tu remarqueras que ces maisons et ces éoliennes sont reléguées dans le lointain. Ce n’est pas pour les annihiler, juste les amoindrir. Les remettre à leur place : qu’elles existent sans tout accaparer !
Dans ces deux images, le sujet principal c’est l’espace. Pouvoir étendre les bras comme si l’on avait douze mille bras. Ou juste une paire d’ailes.
Qui ne voudrait pas être cet oiseau ? S’extraire du terre-à-terre, prendre de la hauteur, contempler la vacuité des uns, la vanité des autres, se reposer de tous. Voler le plus longtemps possible. Le plus haut possible.
L’altitude est ce qui permet de mieux voir l’horizon. Et de ne plus le considérer comme un point à atteindre. Ou pire : une limite à dépasser. L’horizon, par nature, est inatteignable. Mais trop souvent on se laisse avoir et on le confond avec le premier obstacle qui entrave notre route. Jusqu’à se retrouver anéanti, vidé, exsangue. Aussi utile qu’une serpillière usagée qui se dessèche lentement dans l’obscurité d’un rebut cadenassé aux clés volatilisées.
C’est tout le problème du quotidien : une suite de murs en carton qu’on prend pour des murailles en briques. Et contre lesquels on use beaucoup trop d’énergie. Énergie qui fait défaut pour apprécier l’espace. Pour se repaître du vent. Pour ne plus confondre acquérir et conquérir.
Car c’est l’autre problème du quotidien : amasser, entasser, additionner, empiler, agréger, tenir des comptes, cocher des cases, accomplir des missions, résoudre des équations, répondre avec courtoise, se soumettre avec entrain, être soi-même un obstacle, devenir sa propre limite et confondre cette limite avec l’horizon.
J’ignore le sens exact de cet enchevêtrement absurde de contraintes qui ne mènent qu’à d’autres contraintes. Pourquoi notre civilisation s’est-elle construite sur la dépréciation de l’instant et sur l’accumulation de promesses irréalisables plutôt que sur l’harmonie présente ? Pourquoi avoir rendu compliqué ce qui était simple ? Pourquoi avoir rendu inaccessible ce qui était à portée de main ? Cela me fait penser à ce jeune type qui a acquis la gloire et la fortune sur un réseau social en dévoilant la simplicité derrière l’excès de complexité dont se vantent ses confrères et consœurs du même réseau. Tout en étant eux-mêmes de puissants générateurs de faux horizons, ces réseaux sont aussi une parfaite chronique de ces courses éperdues vers des satisfactions d’autant plus provisoires qu’elles sont souvent plus surévaluées que les factures d’une campagne électorale.
Retour aux photos et à leurs éléments communs : la terre, la mer et le ciel. Soit trois immensités absolument interdépendantes. Et ce qui lie ces trois éléments, c’est l’eau. La molécule la plus simple. La plus irremplaçable. La plus malléable aussi. Capable de la pureté la plus immaculée tout en étant la plus encline à se surcharger de toxines.
Tout comme chacun⋅e d’entre nous, l’eau a besoin d’espace. Les masses d’eau — qu’elles soient liquides, solides ou gazeuses — ne sont pas stables car les molécules qu’elles contiennent sont en mouvement permanent. Ballottées, concassées, acheminées, dispersées, pressurisées, évacuées… Enfermées sous terre elle sont contraintes. Obligées de ramper de cavernes en souterrains. De se faire une place parmi les roches écarlates gavées de métaux lourds. De creuser leur lit au plus profond des marnes et des calcaires. Le vent joyeux ou colérique prélève sa part et les disperse au hasard, selon qu’il souffle par ici ou qu’il tempête par-là. Projetées de plus en plus haut, elles retomberont en grappes cristallines pour transpercer de leur lame effilée les boues ensemencées.
Celles que le vent épargne, suivent docilement la pente qui les conduit à l’océan. En chemin, beaucoup iront se perdre entre les rangs bien serrés des potagers productivistes ou dans les conteneurs chauffants des cafetières électriques. Certaines accompagneront le malt et le raisin dans leur dernier voyage avant qu’une glotte les disperse ou qu’un maladroit les fracasse sur le sol froid d’un bar de nuit aux néons fatigués.
Même plongées en haute mer, entre deux caresses de bienvenue aux derniers baleineaux, elles ne sont pas à l’abri d’un changement d’itinéraire soudain, soit qu’une tornade les emporte au-delà du rivage, soit qu’un courant sous-marin les déporte dans les tréfonds d’une nappe où il faudra de nouveau ramper.
Parfois, elles restent en suspension, en équilibre fragile entre le ciel, la terre et la mer. Loin des cavernes et des courants. Enfin libre d’écarter les bras.
Deux images. Comme deux molécules d’eau promenées par le vent.
*

@cosaki_travel | @lrx.clem
▣