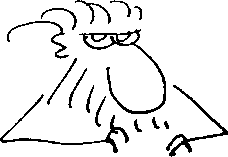Il paraît que les villes — et avant elles, les villages — ont d’abord été conçues pour les éloigner. Pour se sentir protéger de tout ce qui portait dents, griffes ou dards. Pour finalement s’exposer à pire : la guerre qui succède à la guerre et qui ne s’arrête que le temps de préparer une autre guerre. Ce qui finit irrémédiablement à mener à la destruction des villes. Retour à la case départ. Et reconstruction des villes. Sauf si les lions sont eux aussi de retour.
La date exacte de ce retour n’est pas connue. Mais c’était juste après la guerre. L’arrivée du premier spécimen — peut-être du premier groupe — est passée totalement inaperçue au milieu des innombrables problèmes. Des routes impraticables, des immeubles en ruine, des sources contaminées, des vies anéanties, des convois militaires surarmés, des magasins vides… Le quotidien banal d’un lendemain de guerre.
Personne ne leur prêtait beaucoup d’attention. On les pensait échappés d’un zoo ou d’un cirque. Lorsqu’il arrivait de croiser au loin des groupes encore méfiants de félins, le sourire que cela procurait aux enfants atténuait considérablement la peur originelle. Surtout, les priorités étaient ailleurs : manger, s’abriter, retrouver des proches… Et puis les lions ne se montraient pas très agressifs. Beaucoup moins que les policiers chargés de faire évacuer les camps de fortune qui tentaient de redonner vie aux décombres.
Les populations déplacées par la guerre venaient trouver refuge dans cette ville dévastée. L’accueil était inexistant et chacun tentait de se préserver un bout de territoire avec plus ou moins de violence. Les armes de fortune, gourdins, lames ébréchées, chiens affamés, garantissaient l’accès aux rares points d’eau encore potable. Des milices commençaient à s’organiser. Des membres influents des anciennes mafias tentaient de renouer avec leurs pratiques ancestrales. Les militaires chargés de la surveillance des rues étaient cupides et alcooliques. Les bagarres étaient nombreuses. Les victimes ne bénéficiaient d’aucun soin. Ceux que la guerre avaient épargné venaient ici perdre un œil ou un bras.
Le gouvernement avait décidé de reconstruire rapidement. Autant pour que la ville retrouve une partie de son visage d’avant que pour enrichir davantage les nombreux promoteurs qui l’avaient aidé à se maintenir en place. De ce fait, et le ministère s’en vantait fortement, il y avait du travail pour tout le monde. Et donc aucune raison de conserver ou de consolider les déjà maigres aides sociales. Avec comme seul effet, d’accentuer encore la pauvreté d’une population déjà bien démunie.
Contrairement aux prédictions du gouvernement, les bureaux d’embauche étaient très loin de faire le plein. Certains d’entre eux avaient même dû licencier leurs recruteurs ! Il faut dire que les conditions de travail avaient soudainement régressé de quelques siècles. Les outils étaient rudimentaires et tout dommage à l’un d’entre eux était facturé à l’utilisateur. Les salaires, quand salaire il y avait, étaient largement insuffisants et n’étaient attribués que plusieurs semaines après l’envoi d’une demande de versement accompagnée des formulaires d’enregistrement du nombre d’heures travaillées, arrondies à la centaine d’heures inférieures, sur au moins trois chantiers différents. Les protections de base — casques, gants, chaussures, combinaisons, toilettes — étaient inexistantes. Les approvisionnements étaient, paraît-il, en cours. Mais personne n’y croyait. Les plus anciens — ceux qui avaient connu la ville avant la guerre — faisaient le parallèle avec une mystérieuse « politique des masques » sans donner plus d’explication.
Pour qu’un chantier puisse débuter, il fallait d’abord évacuer les familles installées sur la parcelle. Des familles, il en arrivait de partout. Dès qu’une ruine semblait inoccupée, elle était prise d’assaut, donnant lieu à de violentes disputes. Au final, plusieurs familles se mettaient d’accord pour se partager l’endroit et recommencer à vivre. Jusqu’à l’arrivée des premiers géomètres escortés de policiers en tenue de combat — casques, gants, chaussures, combinaisons, fusils à lunette…
Les jets de pierres et les insultes tenaient lieu de discours de bienvenu. Mais très vite, la répression menaçait prioritairement les enfants ce qui dissuadait toute forme de rébellion et se concluait par la mise en œuvre d’un processus de réquisition de « travailleurs volontaires » parmi les membres les mieux portants des familles. Hommes, femmes, enfants. Même les chiens étaient susceptibles d’être emmenés pour tirer des chariots.
Au milieu de cette effervescence improductive en terme de ratio « résultat obtenu / énergie dépensée » — effervescence typique des sociétés humaines dites « civilisées » — les lions s’installaient tranquillement.
La plus grande troupe logeait dans ce qui avait dû être un parc magnifique. Des hectares d’herbes sauvages au milieu desquelles des lambeaux d’arbres s’obstinaient encore à fleurir au printemps. La question de leur élimination s’était posée. Mais l’administration s’aperçut assez vite que là où les lions s’installaient, les familles s’éloignaient sans résistance. Les lions semblaient placides mais aucune cohabitation n’était à l’ordre du jour et la méfiance réciproque était la norme.
Ainsi, les lions ont-ils d’abord été perçus comme des auxiliaires involontaires mais efficaces d’un gouvernement qui préférait y voir une allégorie de sa puissance et transforma l’ensemble de sa panoplie de communication en y intégrant des lions plus ou moins correctement stylisés. Une loi fut rapidement votée pour protéger les grands félins qu’il était désormais interdit de chasser ou d’importuner. La bourgeoisie dont le rôle social est de toujours être au plus proche du pouvoir en place — au point, parfois, de s’y substituer — mit au monde des régiments de Léon et de Léonie. Certains, parmi les courtisans les plus flagorneurs, osèrent même quelques Napoléon…
On ignore si les lions — et toutes les autres bêtes — nomment leurs petits de cette étrange façon. Les nomment-ils d’ailleurs ? Donner un nom dès la naissance n’est-ce pas une forme sournoise d’emprisonnement ? Nommer c’est attribuer définitivement. C’est une façon d’exiger qu’un enfant corresponde aux qualités qu’un nom est censé véhiculer. C’est déjà, pour l’enfant, une obligation de performance. C’est aussi, pour les parents, la porte ouverte à de nombreuses déceptions.
Le premier incident arriva avec les premières lueurs du printemps. Un contingent de bâtisseurs — géomètres, architectes, urbanistes, travailleurs « volontaires », policiers en tenue — s’approcha du plus ancien site occupé par les lions. Placé pas très loin du centre ville, cette gigantesque jachère devait devenir la nouvelle résidence administrative du gouvernement. Il était prévu de déloger calmement les lions en les incitant à se rabattre sur les zones périphériques. La stratégie était d’arriver en nombre au volant de machines énormément bruyantes et d’encercler le site tout en laissant un arc de sortie pour les lions qui, c’était évident, prendraient peur et ne demanderaient pas mieux que de fuir docilement. Mais pas un lion ne daigna montrer un seul cheveu de sa crinière. Malgré les machines, le silence qui émanait de l’ancien jardin était impressionnant. L’absence de vent rendait encore plus étrange le frémissement des broussailles.
Il n’y eut qu’une seule attaque. Fulgurante. Précise. Efficace. Près de trois cent morts selon la préfecture. Au moins le double selon la rumeur populaire. Unanimement, de quoi nourrir tous les carnassiers de la ville. Rats, corneilles, chiens errants… Mais aussi les carnivores les plus audacieux puisqu’aucun blessé ne put être évacué.
Les corps mirent des semaines à disparaître. Après avoir axé toute sa communication sur une proximité honorifique avec les lions, le gouvernement ne pouvait pas soudainement leur faire la chasse. Il fut alors décidé de minimiser l’incident et de frapper plus fort sur les familles expulsées d’autres sites.
Une zone franche entoura le site qui devint rapidement un symbole pour les familles tout autour. Pour certaines, il était un lieu de résistance et devait, en tant que tel, être préservé et servir d’exemple à une rébellion en quête de repères tangibles. Pour d’autres, ce site était la porte de l’enfer et les lions furent associés aux démons de toute sorte. Tout le monde, gouvernement compris, s’accordait sur le fait que ce site devait être sanctuarisé et rendu inaccessible. L’endroit prit officiellement le nom de « Barrière d’Enfer », indiquant que c’était là une limite à ne pas franchir.
D’autres tentatives pour déloger d’autres lions furent mises en œuvre sur d’autres sites de moindre superficie avec chaque fois le même résultat. Si bien que les effectifs venaient à manquer pour ce genre d’opérations. Les autorités décidèrent finalement de laisser les lions s’installer à leur guise. Ce qu’ils firent au-delà de toute estimation, s’invitant parfois au milieu des familles et jusqu’à l’entrée des grandes avenues qui menaient aux palais du gouvernement. Celui-ci fut d’ailleurs tenté de quitter la ville pour en fonder une beaucoup plus loin. Mais cette hypothèse soulevait plus de problèmes qu’elle n’apportait de réponses. Et rien ne garantissait que les lions ne suivraient pas.
Pendant quelques années, la situation est restée explosive. L’afflux de réfugiés ne décroissait pas et le rythme des nouvelles constructions restait faible. Les lions s’attribuaient la moindre zone végétale. Les ruines étaient surchargées d’une population pauvre. Les autorités étaient incompétentes et n’avaient plus que l’emploi de la force pour se maintenir au pouvoir. Entre les deux, et décontenancée par la présence des lions, la middle class tentait de sauver ses meubles et pariait sur une stabilité retrouvée du pouvoir.
Peu à peu, autant par résignation que par habitude, les populations précaires ne se formalisèrent plus de la présence des lions. Il y avait de moins en moins de tension. Chaque groupe vivait sa vie sans empiéter sur les habitudes de l’autre. Les heures de passage aux points d’eau étaient devenues des laboratoires de civilités inter-espèces. Chacun apprenait de l’autre et chaque leçon diminuait la peur.
De très rares accidents étaient encore à déplorer. La plupart des conflits avaient les arbres comme prétexte. Les familles voulaient du bois. Pour construire. Pour se chauffer. Les enfants y voyaient un terrain de jeux pour leurs cabanes et leurs balançoires. Or, les lions avaient fait de la protection des arbres un prérequis non négociable. Un compromis fut trouvé. Lorsque les lions investissaient une zone, ils laissaient quelques arbres morts aux familles. À la seule condition que les enfants n’y grimpent pas.
La caste des hurluberlus se disant philosophes ou prêcheurs travaillait une théorie selon laquelle les arbres — êtres aussi vivants que les humains et les lions — avaient un pacte avec les félins de toute taille. Aussi bien la nature que le contenu de ce pacte était inconnu. Mais l’observation assidue de l’installation des lions dans les parcs à l’abandon avait mené à des constatations surprenantes. Il avait notamment été observé que les arbres habités par les lions croissaient plus rapidement, abritant même de nombreuse espèces d’oiseaux dont certaines étaient déclarées éteintes.
Les arbres était le lieu d’une hiérarchie d’occupation assez complexe. Les lions s’installaient les premiers. S’ils n’occupaient pas toutes les branches, d’autres espèces de félins étaient autorisées à se les approprier tant qu’était respecté le fait de ne jamais mettre un pied sur la branche choisie par un lion. Aussi, pour ces autres félins, il était plus pratique de s’octroyer les branches les plus basses, celles qu’ils pouvaient atteindre sans déranger les lions. Une exception de taille dans ce système rigoureux : les chats. On pouvait en apercevoir dans les branches hautes, dormir avec les lions. On pouvait en voir dans les branches basses, occupés à chasser ou à jouer avec les autres grands félins. On pouvait aussi les voir se promener et dormir en ville, entre les ruines et les bâtiments officiels.
Les chats semblaient avoir tous les droits. Et s’ils ne les avaient pas, ils agissaient tout comme. Il n’y avait que deux types d’inadaptés pour leur courir après : les chiens affamés et les gamins sans éducation. Personne n’arrivait à les enfermer dans une quelconque théorie. Ils étaient à la fois le bien et le mal. Ils étaient à la fois apaisants et inquiétants. Ils étaient les seuls à n’avoir jamais été mangés par un lion.
Cette harmonie naissante entre les familles et les lions ne faisait bien sûr pas les affaires du gouvernement. Les reconstructions ne cessaient pas de ne jamais démarrer et les zones disponibles — celles dédaignées par les lions — étaient de moins en moins nombreuses. Peu à peu, les portraits à crinière disparurent des documents officiels. Il était devenu évident pour tout le monde que les lions avaient leur propre monde, leur propre organisation et qu’il fallait accepter une présence qu’ils savaient rendre à la fois obligatoire et non résiliable.
L’administration était de plus en plus isolée et ses lois de moins en moins respectées. Certains en arrivaient à envier les familles, certes pauvres mais chargées de rêves et d’espoir. Surtout, par superstition plus que par empathie, les autorités n’avaient pas voulu abolir la loi sur la protection des lions. Aussi, les militaires et les policiers attaqués ne pouvaient-ils pas se défendre. S’ils le faisaient — et peu en avait le temps — ils pouvaient se voir condamnés. S’il ne le faisaient pas, ils étaient en partie mangés et leurs restes malodorants étaient un avertissement clair à destination de leurs collègues les plus aventureux. Les désertions furent nombreuses.
À cause de leur passé, les déserteurs n’étaient pas admis au sein des familles. La plupart, ceux ayant échappé aux attaques des lions, s’étaient regroupés par delà les limites historiques de la ville. Parias pour le gouvernement, indésirables pour les familles, appétissants pour les lions, ces hommes et ces femmes redécouvraient la vie des premiers humanoïdes, se confectionnant des couvertures à partir des mauvaises peaux arrachées aux animaux morts et testant, à leurs risques et périls, la toxicité parfois foudroyante des baies et des champignons dont ils se nourrissaient.
Les saisons se succédaient sans qu’aucune avancée, d’un côté ou d’un autre, ne permette de croire à un avenir meilleur. Chacun restait dans son coin. Les inévitables interactions étaient réduites au strict nécessaire.
L’ambiance de la ville commença à véritablement changer lorsque les lions se mirent à danser. On était loin des ballets de l’Opéra de Paris, évidemment, mais cette façon de se déhancher du même pas lorsqu’ils venaient observer des événements festifs, cette appétence euphorique à secouer leur crinière flamboyante, cette élégance naturelle que partagent tous les félins dans leur démarche de funambule expert, tout cela ressemblait fortement à une irrésistible attirance pour ces mots issus du corps que sont les gestes des ballerines.
Les fêtes obligatoires organisées par les autorités étaient peu fréquentées par les familles. Celles-ci avaient leurs propres réjouissances, même s’il était difficile d’accoler le terme de « réjouissances » à des rassemblements encore timides. Il n’y avait pas grand chose à manger ou à boire. Des policiers pouvaient tout interrompre à tout moment. Et puis, d’anniversaires en commémorations, des habitudes et des envies se sont imposées. Des concours de costumes ont occupé les journées. Des dégustations variées ont permis des rencontres. Des familles de différents quartiers ont commencé à se mélanger. Des unions. Des chants, des rythmes, des chorégraphies, des aquarelles, des poèmes. Le défi semblait qu’aucun jour ne devait se passer sans avoir quelque chose à fêter.
Les lions n’étaient jamais bien loin de ces rassemblements. Le bruit ne les dérangeait pas. Il fallait juste éviter les débordements. L’alcool était un expert en débordement et les lions n’appréciaient pas l’alcool. Les alcooliques étaient un calvaire à digérer.
Le lever du soleil était fêté. L’arrivée de la pluie, également. La première feuille morte était ramassée avec délicatesse et faisait le tour du campement sur un lit de paille fleuri de dahlias rouge et noir. Une naissance, un décès, une pierre atteignant le casque d’un policier, un oiseau se posant sur une chaise. Chaque occasion avait sa fête et chaque fête avait ses motifs. Du simple pas de danse accompagné d’un claquement de doigt au plus gigantesque carnaval. Et parmi ces carnavals, celui qui mettait tout le monde d’accord était dédié au jour anniversaire de la première attaque des lions.
D’abord interdite par les autorités — et parce qu’interdite par les autorités — cette fête devint rapidement la plus importante de toutes. Ce jour entérinait la fin de toutes les contrariétés en cours. Plus de chamaillerie, plus de dette, plus de dispute. Le plus matinal des merles donnait le signal du départ. Les musiciens enveloppaient les ruines d’une nappe d’abord discrète entremêlant le long sifflement des flûtes artisanales et les syncopes hypnotiques des claves métalliques fabriquées depuis les fusils récupérés auprès des corps des policiers et militaires qui avait succombé ce jour-là. Les fours de pierres exhalaient une odeur de pain chaud. Les enfants faisaient de leur mieux pour décorer les tartes découpées dans des emporte-pièces évoquant grossièrement la silhouette d’un lion.
Le soir venu, il n’était pas rare de voir de véritables silhouettes félines au plus près des murailles délimitant les territoires. Observateurs silencieux, les lions comprenaient-ils le sens de ce vacarme ? Si oui, l’appréciaient-ils ? Toujours est-il qu’ils étaient de plus en plus nombreux, année après année, à se regrouper pour assister aux spectacles. Jusqu’à venir par petits groupes, d’une démarche calquée sur les sons des tambourins, au plus près des feux et des estrades. Prenant des pauses comme des silences entre deux mesures. Prenant des poses où griffes et crinières devenaient accessoires. Ils n’acceptaient pas encore toutes les offrandes et montraient un réel dédain pour les grillades composées de rongeurs grassouillets. Il se murmurait l’existence d’une dette à ne pas laisser filer vis-à-vis des rats… Une dette qui n’engageait pas les chats à les voir se jeter sur lesdites grillades !
En dehors de ce moment festif, les familles et les lions se croisaient peu. Aux points d’eau. Au pied des arbres où les gamins étaient rapidement informés que leur liberté d’aller et venir s’arrêtait là. Mais du point de vue des autorités, cela ressemblait à une entente. À un début de coalition.
Personne n’a jamais su qui en était responsable. Personne n’a jamais osé non plus se dénoncer. Et pour cause : ce fut certainement l’idée la plus stupide que pouvait avoir un gouvernement en désaveu. Agacé par le fait d’avoir de moins en moins de contrôle sur sa population, paniqué à l’idée que les lions puissent venir les attaquer jusque dans ses palais, le gouvernement décida un jour de participer à sa manière à cette fête d’anniversaire en envoyant ses troupes les plus aguerries. L’idée était de profiter de ce moment de liesse pour se débarrasser et des familles et des lions. Au moins en anéantir le plus possible pour mieux soumettre le reste.
Le massacre fut total. Bien plus achevé que lors de la première attaque puisque cette fois il n’y eut aucun survivant. Des centaines de policiers et de militaires séchaient au soleil comme de vulgaires jambons. Leurs vêtements étaient rassemblés pour être nettoyés, découpés puis recyclés en robes, en sacs ou en rideaux. Les armes étaient démontées. Les munitions désamorcées. Les corps furent déplacés de façon à alimenter au fur et à mesure les chiens dans le besoin.
D’ordinaire, les lions ne s’aventuraient pas en centre ville. Ce jour-là, ils se rendirent jusqu’aux palais officiels. Les chats avaient préparé le terrain. Leur accoutumance docile au milieu humain leur avait enseigné l’art d’ouvrir les portes et les fenêtres. Il fallait bien qu’un jour, cet art se donne en spectacle. Et le spectacle fut grandiose. Portes et fenêtres s’ouvrirent en un crescendo rythmique peuplé de cris et de rugissements allant, eux, decrescendo.
Le carnage dura trois jours. Chaque pièce de chaque bâtiment fut visitée. Chaque recoin fut inspecté. Les lions étaient organisés. Une armée méticuleuse et infaillible. La première vague, musculeuse et rugissante, semait la terreur. Les rares à y échapper tombaient entre les dents d’une deuxième vague, moins brutale mais tout aussi efficace. Une troisième vague, joueuse et pointilleuse, s’assurait que personne n’avait échappé à l’assaut. Enfin, la dernière vague défenestrait les corps encore chauds pour assainir à grands jets d’urine les bâtisses ainsi libérées.
Au soir du troisième jour, alors que le silence n’était plus transpercé que de brèves agonies interrompues d’un dernier coup de griffe aussi précis que la morsure d’une vipère sur la nuque d’une proie inattentive, une foule compacte se massait aux abords des palais, attendant de se livrer à un pillage en règle sitôt que les lions auraient quitté les lieux. Mais ces derniers ne semblaient pas pressés. Les impatients qui tentèrent d’entrer ressortirent eux aussi par une fenêtre, délestés au passage de quelques membres, de leurs viscères et de leur sang.
Le message était clair et bien reçu. À partir de ce jour, la loi des lions était la loi.
Les lions finirent par quitter les bâtiments officiels mais certains s’installèrent directement dans les arbres des jardins, autant pour en surveiller les abords que pour étendre leur territoire. Résignées, les familles rentrèrent chez elles. Mais tout au long du chemin, plutôt qu’une lamentation c’est un chant d’espoir qui passait de bouche en bouche. Les lions étaient certes partout chez eux mais si on ne les contrariaient pas, ils étaient absolument inoffensifs. Et puis il n’y avait plus ni policier ni militaire. Ni gouvernement non plus mais c’était là le plus insignifiant des changements. Les palais étaient inaccessibles mais rien n’interdisait d’aménager les ruines à sa guise. Rien n’interdisait non plus de les déblayer et de reconstruire selon les besoins de chacun.
Des chaînes de solidarité furent rapidement mises en place entre les divers quartiers où résidaient les familles. Certaines avaient pris l’habitude de traverser le territoire des lions, histoire de créer des raccourcis entre les chantiers. Les lions laissaient faire. Tant que personne ne les approchait. Tant que les arbres étaient respectés. Tant que l’eau était respectée. Tant que les familles se respectaient entre elles. Les lions étaient intraitables et châtiaient définitivement toute forme d’irrespect.
La première année fut un chaos sans nom. Ne plus être la cible des policiers et des militaires était un bonheur quotidien. Être privé de gouvernement semblait plutôt bien accepté. Cependant, certains en profitèrent pour tenter de prendre la place laissée vacante. Avant de remarquer que la seule place vraiment vacante était dans la mâchoire des lions. La cohorte des hurluberlus théorisa rapidement l’envie d’être gouverné comme un irrespect de soi.
Il avait fallu adapter les horaires de chantier aux horaires des lions. Les travaux et leurs dégâts collatéraux — bruit, poussière, déplacement, raccourci — n’étaient autorisés que lorsque les lions partaient à la chasse dans les forêts et les prairies au-delà des contreforts de la cité. Soit deux à trois heures tous les deux ou trois jours. Autant dire que les chantiers n’avançaient pas bien vite. Mais l’essentiel n’était pas là.
L’essentiel était que la vie reprenne une courbe douce. Que l’eau soit accessible à tous. Que les arbres aient le temps de grandir. L’essentiel était que le vent apporte des messages et emporte les chagrins. L’essentiel était que le jour et la nuit ne soit plus opposés mais complémentaires.
L’essentiel était que la loi des lions ne soit plus jamais enfreinte, au risque, comme ce fut le cas pour les apprentis politiciens qui voulurent que le monde tourne seulement dans leur sens, de sécher par petits bouts sur les arbres-écoles où les jeunes lionceaux apprenaient l’art de la capture et de l’égorgement.
Les lions étaient de retour et avec eux la vie. La vie d’avant la guerre. La vie d’avant les villes.
Une vie que personne ne songera plus à optimiser, à rationaliser, à capitaliser, à indexer, à diriger, à provisionner ou à déréguler. Une vie qui n’aura pas besoin d’étendre son territoire au détriment des autres vies. Une vie sans rue, sans nom. Une vie où le bel effort n’attendra pas de statue quand bien même il y aurait la place d’en faire.
▣