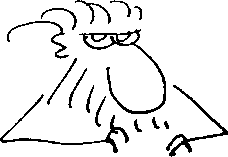Je te préviens tout de suite, cette partie est certainement la moins intéressante du lot. Peut-être la plus mal écrite. Mais elle est nécessaire pour que le lien entre la partie 1 et la partie 3 soit le plus clair possible. J’aurais bien aimé t’annoncer un temps de lecture minimal. Raté. J’aurais bien aimé, également, trouver des formulations plus adéquates. Encore raté. Il faut quand même que je fasse attention. À force de tout rater, je vais finir ministre de la santé…
Bref (si j’ose dire).
En attendant de basculer dans le joli «monde d’après» — car s’il n’est pas joli, ça ne sera qu’un nouveau mais inutile «monde d’avant» — il va falloir patienter et apprendre à cerner cet étrange « monde pendant », à la fois volatile et pesant. C’est un exercice d’autant plus difficile que ses limites temporelles sont inconnues. Autant la fin que le début. Croire que tout cela a subitement commencé il y a un peu plus d’un an est une erreur. C’est probablement en route depuis plusieurs dizaines d’années. Car le temps biologique n’est pas celui de Wall Street. Les virus ne naissent pas aussi subitement qu’une fraude fiscale déguisée en montage financier. Ils n’en ont pas ce caractère prémédité. Non plus que la volonté délibérée de voler, de piller, d’extorquer, d’escroquer, d’accaparer, d’accumuler pour compenser une psychologie amoindrie au service d’un égo boursouflé. Ils peuvent néanmoins se révéler aussi néfastes, aussi meurtriers.
Pour faire court, un virus n’est pas un animal. Juste un ensemble de molécules assez basiques, très proches de celles qu’on peut trouver dans la cellule d’un organisme vivant, mais pourvu d’un ordonnancement particulier qui le rend soit dormant, soit extrêmement dynamique. C’est la même chose avec un bout de métal qui peut devenir, selon son forgeron, le souple réceptacle des plus jolies parures ou la lame insistante traçant les déchirures.
Du fait de cette longue préparation pré-virulence, il y a de fortes chances — ou de gros risques — que le « monde pendant », ce monde actuel qui nous emmerde, possède une durée de vie plus importante qu’espérée. Qu’il va bien falloir occuper autrement qu’en se lamentant sur un confort perdu. Confort tout relatif puisqu’il était loin d’être universel.
Le poids du passé a beau être un frein psychologique majeur, il n’empêche pas les civilisations d’avancer. Notamment les civilisations technologiques. On peut d’ailleurs parfaitement imaginer que le degré d’avancement d’une civilisation est proportionnel au poids du passé que traîne ses populations. Ainsi, plus une civilisation serait techno-dépendante, plus inavouables seraient les consciences qui la pressent d’avancer. Ce n’est qu’une hypothèse un peu bâtarde mais elle cadre assez bien avec l’avènement de la révolution industrielle et le triomphe absolu du capitalisme. Triomphe à la fois économique, financier, technique et culturel. Les États-Unis d’Amérique en sont d’ailleurs le meilleur exemple : ce pays vit depuis plus de trois cents ans sur un cimetière et sa plus grande préoccupation est d’aller conquérir l’espace…
Comme tout le monde, je suis pris dans les tentacules invisibles de cette pandémie — sans être moi-même infecté ou touché par la mort d’un proche — et cela rend difficile d’avoir le recul nécessaire pour en penser correctement les effets à court et long terme. C’est un exercice sémantique proche du funambulisme mais je préfère me casser la gueule sur le terrain des lettres plutôt que d’exhiber, maladroit et honteux, un néant mathématique à côté duquel le vide intersidéral ressemble à une gare parisienne en grève aux heures de pointe ! Du coup, c’est le reproche principal que j’adresse à la communauté humaine ci-devant paniquée : ne plus raisonner qu’en chiffres, ne plus rayonner qu’en nombres ! Depuis qu’une partie de l’humanité s’est auto-proclamée « civilisée » pour tenter de légitimer l’exploitation acharnée qu’elle fait de l’autre partie, il est devenu suspect de ne pas faire intégralement confiance aux équations, aux fractions, aux pourcentages, de ne pas se raccrocher à des courbes dont les inflexions décrivent surtout l’angoisse d’une vraie réflexion.
Cela dit.
Il est tentant de voir dans cette pandémie une allégorie peu flatteuse de la mondialisation économique et de la globalisation culturelle qui en émane. D’en faire la matérialisation d’une timeline devenue folle qui montrerait soudain ce qui est habituellement caché, les « coupés au montage » plutôt que les savants cadrages à destination d’un public fétichiste d’une dolce vita imaginaire. Tentant mais trop simple. Trop facile.
Du coup, sans renier totalement cette vision anti-capitaliste qui, de toute façon, ne sera jamais vraiment fausse, il faut examiner tout ça d’un œil quasiment neutre mais totalement attentif. Et faire attention ne pas tomber dans ses propres pièges rhétoriques en confondant idéal personnel et bien commun.
Je pars des hypothèses suivantes, telles que je pense les avoir identifiées au cours de mes lectures. Ces hypothèses sont forcément — et fortement — liées de sorte que l’invalidation d’une seule entraînera la remise en cause des autres :
- les pandémies font partie intégrante de l’écosystème « planète Terre » ;
- la plupart des pandémies sont dues à des zoonoses, des maladies qui se transmettent directement aux êtres humains par des animaux ;
- les animaux en question peuvent être des animaux d’élevage comme des animaux sauvages ;
- il peut arriver que plusieurs espèces se succèdent dans la chaîne de contamination, rendant la recherche de son origine — essentielle pour sa compréhension — plus difficile ;
- le passage d’un virus de l’animal à l’être humain est facilité par la proximité et la porosité des habitats respectifs de ces espèces ;
- l’aire de propagation d’une pandémie est directement liée aux distances parcourues par les individus infectés et plus ou moins contagieux.
J’y ajoute ces hypothèses personnelles mais difficilement récusables :
- le retard de prise en compte d’une pandémie est directement lié à la peur de la perte (argent, confort, privilèges, proches, etc…) ;
- les réponses inappropriées qui suivent la prise en compte sont directement liées à la volonté d’ostraciser une communauté ;
- les éventuelles thérapies ne sont envisagées que sous l’angle économique et ne sont validées qu’après d’obscures incantations chiffrées.
Or.
Ce n’est pas la première fois que l’humanité est confrontée à une pandémie. Et ce n’est certainement pas la dernière. Sauf si l’actuelle se débrouille pour nous éradiquer totalement, ce dont je doute. Parmi les pandémies du passé, certaines ont été beaucoup plus carnassières. La peste noire du quatorzième siècle, par exemple, aurait décimé, selon des estimations contemporaines, entre le tiers et la moitié des populations ! Ce qui, de nos jours, représenterait entre deux et trois milliards de cadavres ! Nous y arriverons peut-être puisque nous sommes dans l’incertitude sur la fin de cette pandémie. Mais nous en sommes encore loin. Ce ne sont donc pas les chiffres — si grands soient-ils — qui doivent nous préoccuper. Je me répète, je radote, je peste et je râle : dans n’importe quel domaine, les chiffres ne sont qu’un voile plus ou moins opaque dont il convient de s’affranchir pour parler clair. Par nature, le chiffre est manipulable. Et pour des tas de bonnes et de mauvaises raisons, les comptes sont toujours manipulés (piège no 1).
J’en tire rapidement cette première conclusion : aucune leçon n’a jamais été tirée d’un épisode pandémique.
Lors d’un épisode pandémique, ce qui doit nous préoccuper en priorité, voire à l’exclusion de tout autre chose, est la notion de « santé publique ». Peu en importe le coût puisque sans politique de santé publique digne de ce nom, aucune société durable n’est possible. Même les gouvernements les plus imbécilement libéraux ne contestent pas ce besoin. Ils souhaitent simplement que seuls les riches puissent y avoir accès (piège no 2).
Toute santé individuelle dépend directement d’une politique de santé publique. Tu as beau t’alimenter sainement, faire du sport, du yoga ou des mots fléchés force 12, si ton environnement n’est pas sain, ta santé ne le sera pas non plus. Aucun être vivant ne vit dans une bulle étanche et tout ce qui dégrade l’environnement dégrade aussi l’individu. Tu vois où je veux en venir : en tant que société d’êtres humains très largement imparfaits, la santé publique devrait — devra — être notre seul enjeu majeur en matière d’écologie politique (piège no 3). Ce sera justement ce que j’appelle le « monde d’après ». Mais nous en sommes encore loin.
En attendant.
En le cherchant sur Internet, tu trouveras que le concept de santé publique est suffisamment large pour que chacune et chacun tente de l’orienter en son sens. Et de mon côté (piège no 4), j’adhère d’assez près à cette définition, donnée par C.E Winslow en 1920 :
« La santé publique est la science et l’art de prévenir les maladies, de prolonger la vie et de promouvoir la santé et l’efficacité physiques à travers les efforts coordonnés de la communauté pour l’assainissement de l’environnement, le contrôle des infections dans la population, l’éducation de l’individu aux principes de l’hygiène personnelle, l’organisation des services médicaux et infirmiers pour le diagnostic précoce et le traitement préventif des pathologies, le développement des dispositifs sociaux qui assureront à chacun un niveau de vie adéquat pour le maintien de la santé, l’objet final étant de permettre à chaque individu de jouir de son droit inné à la santé et à la longévité. » (source)
De fait, pour tout être vivant, la santé est primordiale. Au point que l’expression « être en bonne santé » peut être vue comme un pléonasme redondant à répétition itérative. Toute action physiologique, quelque soit son ampleur, participe à la conservation ou à la détérioration de cette santé. Question de dosage. Et de métabolisme. Respirer, manger, dormir, péter… ces actes sont basiques mais essentiels. Respirer un air non pollué, manger sainement, dormir comme un triple grizzly en hiver, péter plus ou moins discrètement selon le seuil de tolérance de ton entourage… Mais pour aussi vitale qu’elle soit, la santé est de santé fragile. Elle est aussi un brin hypocondriaque. Un rien la perturbe et trois fois rien la triture. Être mordue par une petite bête ou digérée par une plus grosse, recevoir un coup du sort ou un coup derrière la tête, tout lui sera prétexte pour décliner et réclamer force potions amères — de préférence verdâtres et non alcoolisées — complétées par moult repos all inclusive le long de golfes plus ou moins clairs.
Dans une société correctement organisée, ce qui est dit « public » se gère en commun. Ainsi, le terme « santé publique » draine avec lui des notions qui ne relèvent pas que de la biologie mais également de la politique au sens propre (la gestion de la vie commune) et plus précisément de la logistique. C’est-à-dire de l’organisation et de la coordination du personnel et du matériel nécessaire à une action.
Ce n’est pas le nombre de personnes concernées par ceci ou cela qui rend ceci ou cela public, c’est l’accessibilité du ceci-cela à ce nombre, quel que soit ce nombre. Y compris zéro. Un réverbère allumé malgré la rue vide, un tableau noir dans une école fermée pour les vacances ou bien un règlement intérieur poussiéreux dans une assemblée d’absentéistes restent de nature publique. Bien plus que les soirées échangistes entre les élus de droite et de gauche dans la salle des coffres de n’importe quelle banque privée (ceci n’est pas un piège).
Cette pandémie qui détériore nombre de santés individuelles est évidemment un problème de santé publique puisqu’elle altère la capacité d’action de l’ensemble de la société en la privant plus ou moins définitivement d’une partie de ses forces. Un peu comme un lierre qui étoufferait un arbre, puis un autre et menacerait, in fine, l’ensemble de la forêt.
Sur un individu isolé, un problème de santé est un banal problème biologique. Ni plus ni moins qu’une histoire de tissu ou d’organe agressé mais plus ou moins auto-réparable tant que l’agression ne confine pas à la destruction dudit tissu ou organe. Tu te casses le bras en tombant de tes skis n’est pas un problème de santé publique. Et dans une société idéale, les soins afférents ne devraient pas, en toute logique, être pris en charge par la communauté car un os est tout à fait capable de se ressouder tout seul. Il lui faut juste du temps et des gestes mesurés durant ce laps de temps.
En revanche, si le bras cassé en vient, sous le choc, à se détacher, à dévaler la piste pour finir par obstruer — pour s’y décomposer — la gaine d’aération qui permet de réguler la température des chambres froides dans lesquelles sont conservés les fromages à fondue, contaminant ainsi l’ensemble du travail coopératif de l’immense majorité des résidents permanents du domaine skiable, alors, une question de santé publique pourra, dans ce cas, être légitimement soulevée.
Tout problème de santé publique doit être considéré comme un problème écologique majeur s’il remet en cause l’existence même de l’écosystème agressé et doit devenir la priorité absolue de quiconque (personne ou groupes de personnes) est en charge de la communauté. Les problèmes de santé publique ne sont pas l’apanage des êtres humains. La disparation — ou la menace de disparition — de certains rongeurs, oiseaux, mammifères ou insectes est un problème de santé publique puisque ces disparitions peuvent impacter sévèrement les récoltes ou favoriser certaines pandémies. À contrario, une trop forte présence de ces mêmes petites bêtes sera également un problème de santé publique pour exactement les mêmes raisons.
Reprenons l’exemple des forêts. Pour ne pas se laisser étouffer, les forêts doivent posséder des mécanismes de régulation non seulement pour se protéger de l’étouffement collectif mais également pour accepter le développement du lierre. De son côté, le lierre doit avoir un mécanisme du même ordre qui le rend impuissant à étouffer toute une forêt mais apte à se repaître de quelques arbres. Une organisation proie-prédateur conçue dans l’intérêt des deux parties. C’est le principe d’un écosystème : une place pour chacun et chacun à sa place. Avec parfois quelques débordements d’un côté ou de l’autre mais sans étouffement et sans développement illimité. Le lierre a besoin de la forêt pour se développer. La forêt a besoin du lierre pour modérer son développement. Que les arbres étouffés soient choisis au hasard par le lierre ou offerts par la forêt, ne change pas grand chose à la finalité de ce système bien que ce critère est important pour mieux comprendre l’ensemble du mécanisme. Et je suppose que tous les écosystèmes ont un fonctionnement à peu près similaire. Avec une exception. Tu devines laquelle.
Car bien qu’elles sont capables de parfaitement réguler d’autres écosystèmes, la plupart des sociétés humaines agissent comme des écosystèmes dérégulés. C’est à la fois une défaillance et une erreur de n’avoir aucune limite en aucune chose. Et l’infinitude de l’univers n’est ni un prétexte ni une excuse. Encore moins un modèle.
« Jalousie des grands arbres ?
C’est gravé dans le marbre !
Erreurs et défaillances ?
C’est peint sur la faïence. »
L’infini n’a de sens que par rapport aux finitudes qu’il véhicule. Un contenant. Du contenu. Pas l’inverse. Il en va de même pour les sociétés humaines qui devront se résoudre à n’être qu’une partie de cet ensemble. Ne plus se concevoir « hors sol ». Ne plus rien imaginer d’infini, capacités intellectuelles ou ressources naturelles. Elles ne le sont pas. Pas plus que le pouvoir ou la richesse. Pas plus, à l’autre bout du spectre, que la misère ou la bêtise malgré ce qu’en disait Einstein, humoriste bien connu. L’univers est le seul infini. À l’intérieur tout est fini. Même ce texte qui commence à se prendre pour un odieux capitaliste en occupant plus de place que nécessaire.
Le monde d’après devra être celui de la solidarité à tous les étages de la grande maison homo sapiens. Du douzième sous-sol au soixante-neuvième étage. Solidarité partout. Égoïsme nulle part. N’être enfin qu’une partie du tout. Naître enfin sans patrie, sans atout. Autrement, ce ne sera pas le « monde d’après ». Juste un retour à un autre « monde d’avant » qui ne débouchera, fatalement, que sur un nouveau « monde pendant ». Jusqu’au prochain encombre de catégorie 1.
▣