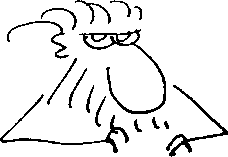Lorsque j’étais tout petit (c’est-à-dire hier matin, à peu près), les images étaient rares et cette rareté donnait à n’importe laquelle d’entre elles une valeur inestimable. Les téléviseurs noir et blanc arrivaient à peine dans les foyers ouvriers, la publicité n’avait pas encore envahi tout l’espace disponible et la photographie était un luxe.
En même temps, le cinéma devenait de plus en plus populaire et des salles de quartier s’ouvraient un peu partout. Les illustrés — ces bandes dessinées de qualité moyenne — trouvaient leur place dans les cartables. Dans le mien, les aventures d’Akim et de Zembla, les rois d’une jungle cocasse, des Tarzan kitschissimes en slip léopard accompagnés d’animaux dénaturés. Une marque de chocolat basait toute sa communication sur la présence d’images à collectionner dans ses produits. L’école en offrait en guise de récompense. Les politiciens apprenaient à se servir de la télévision et forçaient sur la solennité comme leurs électeurs sur le beaujolais.
Si tu me lis depuis longtemps, tu le sais déjà : ma mémoire est une fugitive récidiviste. Une spécialiste de l’évasion. Un puits sans fond dans lequel s’est perdue mon enfance, laissant sur la margelle d’icelui de drôles d’images plus ou moins indéchiffrables. Mais déchiffre-t-on vraiment les images qui nous assaillent ? Où se situe la réalité ? Dans le doigt de celui qui montre ou dans l’œil de celui qui regarde ?
Je te (re)parle de tout ça car le hasard vient encore de me jouer un tour à sa façon, discrète et incontournable.
Ce matin, je passe à la Bibliothèque de Paris pour rendre un ouvrage. Puis je parcours les rayons au hasard pour voir ce que celui-ci me conseillera. Ne me sentant pas très inspiré par ce que je vois, je me dirige vers la sortie et là, bien sûr, un livre attire mon attention. Rangé à plat sur le présentoir réservé aux romans japonais contemporains. Un titre sympathique. Une auteure que je ne connais pas. Je feuillette. Je regarde ses voisins qui me hèlent comme le font les chats et chiens des refuges de la SPA quand des enfants courent entre les cages, rêvant de tous les ramener, mais je les ignore. Pas envie de me trimballer trois kilos de livres dans les poches.
Dehors, le soleil s’est installé et a ramené son grand copain le froid. Du coup, je rentre en métro et je commence à lire.
Il y a des livres qui te donne envie d’écrire, de reproduire, en fait, les images énoncées quitte à les enrober de teintures, de tournures, de boursouflures, de toutes ces blessures dont une écriture est porteuse et qu’elle expose avec l’indécence d’un professeur d’anatomie dans un camp naturiste. Inversement, il y a des livres qui te donneraient (presque) envie d’arrêter d’écrire, incapable que tu es de construire des phrases lumineuses éclairant des histoires universelles. Bizarrement, celui-ci est entre les deux.
Manuscrit Zéro ou l’évidence de l’art.
Un recueil de textes courts de Yôko Ogawa aux Éditions Actes Sud, 2011.
Première page. C’est important une première page. C’est comme un premier rendez-vous. Tu comprends rapidement si tu vas devoir, au choix, trouver une excuse bidon pour t’enfuir en courant ou dire adieu aux mille et un morceaux de ton cœur partis jouer aux étoiles filantes tandis que le vent les disperse dans un univers parallèle.
Première page et je sais que je le lirais jusqu’au bout. Je prendrais du retard dans mon travail en cours, tant pis. Pas dans les textes que je t’ai promis pour la fin décembre. Tu les auras à cette date. Du retard dans la partie technique du site que je voulais mettre en place pour ces textes. Mais cette partie n’avançait pas beaucoup de toute façon.
Première page, donc. L’auteure dans le taxi qui l’emmène dans un coin perdu de campagne. Une description qui fait penser à un suiboku de Sesshū Tōyō (je te rassure, je suis allé voir sur Wikipédia pour les noms exacts). Un peu d’humour en plus.
— À l’époque du rougeoiement des feuilles, ici aussi ça doit être animé, n’est-ce pas ?
— Non, pas tant que ça.
Taciturne, le chauffeur s’exprimait brièvement.
— Ici on est à environ mille cinq cents mètres d’altitude ?
— Non, pas tant que ça.
— Ça va prendre encore un certain temps ?
— Non, pas tant que ça.
Et puis surtout, par la suite, une façon d’entremêler un imaginaire solide et une réalité mouvante. De passer en une phrase d’un côté du miroir à l’autre. De surprendre par une banalité. Avec ingénuité, presque. Avec un génie consommé et un art de l’ellipse. Tout en douceur. La légèreté et l’innocence du papillon au-dessus du mûrier. Qui sait parfaitement que ses battements d’ailes provoqueront quelque part une tempête dévastatrice et qui feint cependant de n’être qu’un papillon voletant au-dessus du mûrier. Un papillon aux ailes d’un bleu mélancolique et profond comme le puits rebouché sur lequel a poussé un figuier…
Yôko Ogawa manie parfaitement la dualité des images et les diverses représentations qui peuvent émaner d’une situation. Elle sait emmener ses histoires fantasmatiques au bord extrême de la crédibilité pour soudain les ramener dans le champ d’un quotidien ordinaire mais sur lequel flotte désormais un léger parfum d’épices.
Ses textes sont des sushis bardés de couleurs familières qui dissimulent au mieux des arômes improbables de mousses de sous-bois, des tendresses musicales issues du fond des mers, des blancheurs éclatantes d’écoliers festifs, des soupçons d’oiseaux et de tournesols, présentés sur un papier largement quadrillé sur lequel la plume et la gomme glissent chacune à leur tour en un duel insensé et incessant.
Où est la réalité ? Où est l’imaginaire ? J’imagine donc j’existe. Et inversement. La vieille histoire de l’œuf et de la poule. Indissociables. Se créant et s’excluant, mutuellement et simultanément.
Tout compte fait, ce livre m’inciterait plutôt à continuer d’écrire. À retracer mon existence en déroulant mon imaginaire. À rechercher dans mes inventions lexicales les fossiles évanouis de mes premiers instants. Mais ces fossiles ont-ils seulement existé ? Au point où j’en suis, la disparition d’une inexistence imaginaire pourrait parfaitement n’être que l’image d’une réalité absente ?
Manugraphie zéro, ou l’absence de l’art.
C’est cette construction d’images qui me prend du temps. J’ai choisi délibérément de n’être pas trop explicite dans les descriptions des fumées impalpables qui sont ce qui reste de plus stable quand je fouille ma mémoire. Les mots ne sont pas faits pour expliciter précisément. Au contraire. Les mots sont faits pour cacher, pour détourner, pour mentir. J’y reviendrais certainement dans un prochain texte.
J’aurais préféré être dessinateur.
J’ai toujours considéré le dessin comme le premier des arts, le seul même. Je mets la musique à part, au-dessus de tout. Je te l’ai déjà expliqué mais c’est une idée un peu complexe. Surtout avec mes mots.
Le dessin est à la base de tout : la peinture, bien sûr, mais aussi l’écriture par la calligraphie, et la danse, par l’ampleur des gestuelles. Je jalouse beaucoup les dessinateurs. Capturer un mouvement, le figer sur un support — papier Canson ou paroi des cavernes — voir ce mouvement à nouveau en vie, se répéter sans cesse dans un trait précis comme un poisson tournoyant dans son bocal, prisonnier mais vivant, observable et transmissible. Il faudrait un dessin pour expliquer le dessin. Les mots ne suffisent pas.
Pour tenter de combler ce manque entre l’écrit et le dessin, je me promène souvent avec un appareil photo.
Les images qu’il me permet ne sont pas forcément plus explicites que mes mots mais contrairement à ces derniers, elles figent un instant, elles arrêtent le temps, le temps d’une infime fraction de seconde. Elles se laissent enfermer dans des mémoires numériques et jouent leur rôle thérapeutique : elles apaisent, au moment où le doigt presse le déclencheur, une tension que les mots exciteraient.
▣