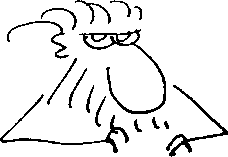Le hasard, je t’en ai déjà parlé ? C’est cet ami capricieux, imprévisible mais irremplaçable, qui sème sur ma route des indices plus ou moins luminescents me permettant de développer certaines idées et d’avancer sur des textes jusqu’alors incertains.
Exemple.
Dimanche matin, Belleville. Direction le bureau de vote n° 73 pour honorer la procuration que m’a confiée Clémence.
De chez moi, le plus rapide c’est de prendre le métro, de descendre à Jourdain et de glisser tranquillement le long de la rue des Pyrénées jusqu’à l’angle de la rue de Ménilmontant. Ça, c’était avant que le hasard ne s’en mêle. Et qu’il ne bloque la ligne 11 pour une obscure « raison voyageur »… Durée estimée avant la reprise du trafic : une heure.
Ma claustrophobie et ma patience tiennent un rapide conciliabule et s’unissent pour refuser de passer soixante minutes à l’étroit dans une rame bien que je leur fais remarquer qu’être à l’arrêt dans un souterrain de la station République en ce jour de vote si important a quelque chose qui hésite entre le sarcasme et l’ironie… Je sors donc précipitamment et remonte la rue du Faubourg du Temple. Contrairement à son habitude, parce qu’il est tôt et qu’on est dimanche, cette rue est déserte. Ce qui n’est pas pour me déplaire. Conseil de vieux parisien : promène-toi dans la ville le dimanche matin de bonne heure. Tu la découvriras sous un nouveau jour. Méfie-toi, cependant : tu risques d’en tomber amoureux·se…
Arrivé en haut de cette rue, je prends à droite sur le boulevard de Belleville (mais je vote à gauche, je te rassure), nullement impressionné par l’idée de me taper, un peu plus loin, la pente vertigineuse de la rue de Ménilmontant.
Et puis.
Peu après la station Couronnes, un panneau Histoire de Paris attire mon attention. D’ordinaire, ces panneaux sont situés au pied de bâtiments anciens et remarquables ce qui n’est pas le cas à cet endroit oublié de l’architecture et seulement bâti de blocs de béton trop rapidement recouverts d’un enduit de mauvaise qualité. Je m’approche. Et j’y lis cette histoire.
« Le métro parisien, encore tout neuf, connut ici, entre les stations Couronnes et Ménilmontant, la première catastrophe de son histoire, le 10 août 1903. À l’époque, les wagons étaient en bois, ce soir-là, un train prit feu après un court-circuit électrique. Les voyageurs, trompés par l’obscurité et la fumée de l’incendie, se bousculèrent pour gagner les sorties ; asphyxiés ou étouffés contre le mur où ils croyaient trouver une issue, il y eut 84 morts. Cette tragédie frappa très vivement l’opinion publique, tant en France qu’à l’étranger. Elle provoqua une réorganisation des normes de sécurité, avec l’installation d’un éclairage de secours indépendant de celui des souterrains et des stations, la création de postes d’incendie dans chaque station, et le remplacement des bancs d’attente par des banquettes fixes. »
Aussitôt, mon esprit jusqu’alors accaparé par l’élection du jour me signale que cette triste histoire est possiblement complémentaire du texte précédent. Pour rappel, il y était question, entre autre, de technologie dont la constante évolution était prise entre trois états imbriqués mais parfois antinomiques : la science (le désir de connaissances), l’État (la conservation et la transmission des connaissances) et la vérité (la variabilité des connaissances).
Et de fait, ce malheureux incendie du métro apporte un éclairage qui peut fort bien servir de socle à toute réflexion sur la science, l’État et la vérité.
Dont acte.
Qui aurait pu imaginer (© Petit-Macron), en cette lointaine année 1903, les conséquences d’un incendie dans un tunnel étroit dépourvu d’éclairage et de ventilation ? Ce n’est pas comme si la déformation des matériaux sous contraintes, les exigences de déplacement d’une foule en urgence et les causes probables d’un incendie étaient les grandes oubliées de la connaissance.
Après tout, les hommes exploitent des minerais souterrains depuis seulement quelques siècles en utilisant pour cela des galeries étayées de bois et parcourues par des wagonnets transportant le résultat des extractions, le tout rythmé par le va et vient incessant de centaines d’humains exténués.
Bien sûr, les galeries des mines et celles du métro parisien ne sont pas tout à fait comparables. Les galeries du métro sont moins profondes, plus rectilignes et possèdent une issue à chaque extrémité. Mais fondamentalement, l’ingénierie nécessaire à la construction et à la maintenance de galeries souterraines est la même. Du coup, cet incendie est-il le résultat d’une ignorance, d’une erreur ou d’une négligence ? En d’autres termes, cette catastrophe aurait-elle pu être, sinon évitée (le risque zéro n’existe pas), du moins minimisée ?
Toute ressemblance avec une situation politique extrêmement récente n’est évidemment pas fortuite et justifie pleinement le titre de cet article.
Car.
De la même façon que la technologie ne fait qu’améliorer les défaillances des outils existants sans se poser la question de leur intérêt réel donc de leur remplacement, les gouvernements ne font jamais marche arrière et collectionnent jusqu’à la nausée des lois rectificatives qui sont comme des sparadraps éphémères et des lotions inefficaces sur des plaies toujours ouvertes. Jusqu’à ce qu’une catastrophe, industrielle ou sociale, oblige à de plus profondes réflexions et de meilleurs contrôles sur les processus autant qu’à de profondes réformes à la fois économiques et constitutionnelles.
Et puis, le naturel revenant au galop, on se rendort satisfait en attendant la prochaine catastrophe.
La seule différence est que dans le monde technologique, les avancées sont réellement, pour la plupart, des progrès dans de nombreux domaines (de la conception à l’utilisation) pour peu qu’on soit du bon côté économique de cette technologie.
D’où vient que dans le domaine politique, cette amélioration est, soit inexistante, soit infinitésimale ? Là où la technologie avance à pas de géant dopé à l’EPO, la politique se contente de petits pas précautionneux tel un mille-pattes unijambiste englué dans une marée d’idées noires.
Concernant la catastrophe électorale en cours — catastrophe parfaitement mondialisée — les signes avant-coureurs ont été nombreux et puissants. Ils ont appelés, ils ont criés, ils ont agité leurs petits bras comme des désespérés sur un îlot regardant s’éloigner, dans un maelstrom de lumières flashy et de ritournelles décervelantes, le paquebot de l’indifférence et du mépris.
Si on ne s’attache qu’à ce qui se passe en France, ce pays dont l’origine, l’atavisme, la raison d’être et la richesse est sa propension à rendre français.e quiconque s’installe sur son territoire, les signes les plus tangibles remontent à un demi-siècle. Une éternité pour les jeunes. Un claquement de doigts pour moi. 1974. Élection présidentielle. De nouveaux visages. Le fasciste Jean-Marie Le Pen. L’écologiste René Dumont. La montée inexorable du nationalisme imbécile s’est accélérée à cette époque.
Le nationalisme a toujours fait partie des diverses composantes idéologiques d’une nation. Il est même, sémantique oblige, à l’origine de l’idée de nation. Il a connu son paroxysme de haine et de violence dans les années 30 et 40 et s’est fait discret par la suite, sans jamais vraiment disparaître.
Mais, très clairement, 1974 marque le moment où les politiciens établis ont décidé en conscience d’ignorer l’écologie pour jouer avec la peur de l’extrême-droite afin de se maintenir au pouvoir. Tous sont à la fois responsables et coupables du chaos à venir.
1981 a été une éclaircie qu’on a pris pour un nouveau jour et qui n’était qu’un dernier feu follet. Comme pour nous rappeler qu’on n’était pas passé loin, qu’il suffisait de faire encore un effort plutôt que de se vautrer dans la boue des années 80. L’argent devenu facile pour des banquiers en roue libre. La désindustrialisation des territoires et l’ensemencement toxique. L’égoïsme social, le culte de soi. Des miroirs partout et des millions d’alouettes éperdues d’elles-même. Une mondialisation financière plutôt que culturelle. Une Europe asservie aux États-Unis.
La chute du mur de Berlin, vécue par l’Occident comme l’open bar du capitalisme libéral. La révolution du web qui promettait de mieux partager l’information et qui s’est rapidement transformée en gigantesque galerie marchande sans foi ni loi. Les crises paysannes, les manifestations anti-nucléaires, les « Nuit Debout », les « gilets jaunes », les manifestations pour plus de justice sociale, pour plus de justice tout court face à un État dont la police est devenue l’une des plus violentes d’Europe… Le décompte est infini et malheureusement inutile.
Il est facile d’insulter ces électeurs et ces électrices qui ont choisi le recours à des valeurs fantasmatiques dans lesquelles la violence contre autrui est une composante majeure. Mais ce ne sera pas suffisant pour nous éviter d’être submergé·es par ce tsunami de haine et de désordre contre lequel il y a peu de remparts.
Mais peu ne veut pas dire aucun.
En premier lieu, prendre conscience qu’en politique, il n’y a pas de vérité (coucou, la revoilà) intrinsèque ou universelle. Dire à quiconque qu’iel a tort de voter pour X ou Y est absolument contre-productif. Même si c’est dit gentiment. Même en employant des tonnes d’arguments factuels. Tu peux apprendre la propreté à ton chien en lui mettant le nez dedans. Ça ne fonctionne pas avec les radicalisés. Et les électeurs et électrices de l’extrême-droite, pour la plupart, sont des radicalisé·es. Ce sont les fiché·es « S » du suffrage universel. Et parmi ces radicalisé·es il y a une forte proportion de futures victimes de ce vote : des femmes, des enfants d’immigré·es, des israélites, des intellectuel·les, des artistes (assez peu, il est vrai), etc. L’âme humaine est si complexe qu’elle donne parfois envie de devenir un caillou pour disserter paisiblement sur la nature de l’espèce. D’autant qu’en anglais, caillou se dit rock… Mais ce n’est pas le sujet.
Deuxièmement, laisser passer l’orage. Sans baisser la tête ni courber le dos. Il ne faut pas exagérer non plus. La France possède une tradition bien ancrée de bouleversements sociétaux décidés à l’arrache puis lissés, voire oubliés, avec le temps. Évidemment, ce temps est incalculable. Il ne s’agit donc pas d’attendre qu’il passe de son plein gré. Il faut lui filer un coup de main de la manière la plus simple qui soit : continuer de vivre, de rire, d’aimer, de rencontrer, d’oser, de confronter, d’apprendre, de transmettre. Et, avec un peu de chance (car il en faut), voir ces graines lever et former une forêt joyeuse qui protégera longtemps du vent mauvais.
Enfin, et surtout, car c’est ce dont on a le plus manqué jusqu’à présent, ne jamais abandonner la vigilance. Pas un jour. Pas même une minute. Il suffit d’un clignement d’œil inattentif pour que la bête nous saute à la gorge. C’est toute l’histoire de l’accession au confort matériel qui rend amorphe et dépendant. La faim et le manque emmènent les gens à gauche, la peur et la vénalité les ramènent à droite. La surconsommation, le sur-tourisme, la surmédicalisation, le sur-hygiénisme, assurent mieux qu’une armée le maintien d’une population dans cette zone de confort si douillette et si dangereuse à la fois. Douillette pour soi. C’est cool. Dangereuse pour la collectivité. Donc pour soi.
Il faudra bien un jour trouver un équilibre. Consentir à ne plus rien hiérarchiser. Accepter toutes les formes de beauté et d’intelligence. De mocheté et de bêtise aussi. Car je compte bien continuer d’écrire.
Plus que jamais, prends soin de toi. Et des autres.
▣