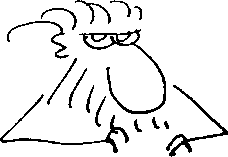Le dieu des parkings doit en vouloir à cette porte : ouverte jour et nuit, elle ne protège plus le sous-sol de l’immeuble des allées et venues frauduleuses des inautomobilistes nocturnes. Les fils de ses circuits qui pendouillent, le ruban rouge et blanc qui en délimite la carcasse font penser à une opération à cœur ouvert soudainement interrompue. Comme si le personnel qui avait commencé à démonter le mécanisme s’était d’un coup volatilisé sans que personne ne s’en aperçoive.
Je ne vais évidemment pas m’en plaindre !
Paris est toujours à l’heure d’hiver. Il neigeotte canaille et froidotte grelument. Le climat semble vouloir m’accueillir avec les honneurs carcéraux : si tu résistes à cette nuit polaire, je t’en balancerais d’autres sur le coin de ta sale gueule !
Hey ! Mais je t’ai rien fait, moi, au climat. Pas plus que les autres, en tout cas…
Histoire de ne pas me fâcher tout de suite avec les propriétaires des autos, je pisse à l’extérieur et manque de peu de me geler la bite. Ça s’est joué à trois gouttes… quatre, peut-être.
Je repère une auto plus poussiéreuse que ses sœurs de misère. J’en déduis qu’elle ne bouge pas souvent et que ce ne serait vraiment pas de bol qu’elle fasse office cette nuit-là ! Je pose mes sacs et déroule mon duvet à même un sol que je qualifierais de propre pour un garage. De la poussière, certes, mais pas une seule goutte d’huile. Les nombreuses berlines allemandes entreposées là sont bien entretenues.
Je dors habillé. Moins la veste, le gilet et les pompes. Et les lunettes. La présence sournoise de courants d’air insidieux m’oblige à souvent changer de position. Je m’endors par intermittence. De temps en temps, quelques voitures reprennent sagement leur place dans le rectangle de peinture blanche qui leur est dévolu. Je m’attends à de la visite mais non. Une porte claque, des pas s’éloignent. Je me rendors.
Au matin, j’ai froid.
D’autres voitures défilent. Cette fois, du sous-sol vers la rue. Des talons pressés, des démarrages hâtifs, des cris d’enfants qu’on emmène à l’école… Il doit être encore tôt. Je me lève et remets précipitamment pompes, gilet, veste et lunettes. L’opération suivante est délicate : ré-enrouler le duvet de manière à ce qu’il daigne à nouveau prendre place dans l’enveloppe ridicule qui lui sert de housse… Pas sûr qu’elle suffirait à contenir la roccondité de certains pornocrates le jour de l’ouverture de la pêche aux moules ! À force de contorsions dans des positions qui feraient démissionner un pape, et aidé par quelques mots bien crûs qui résonnent encore contre les parpaings nus du sous-sol, le duvet finit par s’enhousser et m’incite à fredonner du Gainsbourg : J’ai un Mickey mahousse, à l’abri dans sa housse…
Une porte claque et des pas s’éloignent. Je n’ai rien à claquer mais m’éloigne également.
Dehors, rien n’a changé, météorologiquement parlant. Au quatrième top il neigeottera exactement canaille et froidottera tout aussi grelument.
Je me dirige vers la Gare de Bercy dont je compte faire un de mes QG. Cette gare, je l’ai emprunté pendant des années, du temps que j’habitais l’Yonne et travaillais en banlieue parisienne. Mais ce n’est pas la nostalgie qui m’y pousse. Je la sais équipée d’une salle d’attente chauffée, de toilettes propres à 50 centimes et de prises électriques nombreuses qui me permettront d’avancer autant sur mes textes que sur mes projets web même si ces projets ne me permettront pas d’inverser la courbe qui m’emmène bien en-deçà du tout premier barreau de l’échelle sociale… Ce n’est peut-être pas plus mal pour mon vertige ! Par contre je ne reçois pas le wifi « gratuit » qu’il suffit de payer… Et je devrais aller voir ailleurs pour la douche…
J’arrive vers dix heures — grasse matinée inside — je branche le PC et je reste là toute la journée à pianoter maladroitement du code informatique, plus obtus que je ne le pensais, en me gavant de musique, les écouteurs dans les oreilles. Volume suffisamment bas cependant pour, d’une part, ne pas me flinguer le tympan, et, d’autre part, me marrer à chaque annonce micro des préposés de la SNCF qui semblent jouer leur vie dès qu’un train a du retard !
Entre deux séances de code, je reprends mes textes. Au moins, ces projets informatiques m’occupent l’esprit de manière plus ordonnée — à peine plus ordonnée — que ces putains de textes qui refusent encore de franchir l’océan qui sépare le clavier d’où je les brouillonne de l’écran d’où tu les liras.
Le soir, peu avant que la gare ne ferme, je m’engouffre dans le métro et voyage sur quelques lignes, d’un bout à l’autre de l’ennui. Histoire de passer le temps. Histoire de stocker quelques degrés avant de retourner dehors. Histoire de faire encore partie du monde… bien que sans téléphone, sans radio, sans internet, je me sens quand même un brin isolé. Et puis le métro est plein d’histoires potentielles…
Fatigué, je regagne le parking en espérant que la porte n’a pas été réparée… Bingo ! Je serais encore à l’abri du vent ce soir.
Cette fois je descend au deuxième sous-sol, moins exposé aux courants d’air. Point de voiture poussiéreuse à l’horizon. Je choisis donc un petit modèle qui me laisse plus de place. Aussi parce que le conducteur — qui, au matin, se révèlera être une conductrice — a laissé suffisamment d’espace entre son coffre et le mur. Double avantage : un, la voiture fait écran entre moi et les néons du sous-sol et deux, elle me dissimule un peu mieux des regards.
Bonne idée d’être descendu d’un étage, je dors mieux.
Au matin, des pas, une voix d’enfant. Merde ! C’est justement cette voiture qui s’en va ! La conductrice me prévient gentiment qu’elle va démarrer et qu’elle ne voudrait pas que son pot d’échappement m’asphyxie. Je la rassure sur ce point. Avant de démarrer, elle me laisse une bouteille d’eau. C’est cool, merci !
Du coup, je décide de laisser là mes affaires (le sac de fringues plus le duvet). Je garde juste le petit sac à dos pour le PC et son chargeur puis me dirige vers la gare.
Il est dix heures. Paris a eu le temps de s’éveiller. Je commence ma journée. Un chocolat chaud pour démarrer. Ce sera mon seul repas aujourd’hui. Le dossier RSA est en cours, paraît-il… As-tu déjà imaginé tout ce qui pouvait se cacher derrière un dossier en cours ? Cette pauvre liasse de papier et ses cases à cocher, voyageant, imperturbable, de bureau en bureau, examinée, posée, recouverte, découverte, rejetée, tamponnée, acheminée, distribuée, égarée, retardée… Les dossiers en cours sont un peu les SDF de l’administration.
Cet après-midi j’irai m’inscrire dans une des bibliothèques de la ville de Paris. Un autre havre chauffé. J’y capterais peut-être le wifi ? Sinon, il faudra que je trouve un cyber-café pour te poster ça…
▣