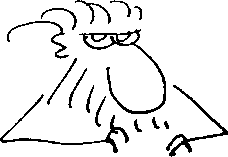Qui n’a pas entendu dire que la vie était — à tour de rôle et parfois concomitamment — ou belle, ou dure, ou courte mais surtout irremplaçable ? En fait, plus j’y pense et plus je me persuade que le seul qualificatif qui lui convient est celui d’ironique. La vie est absolument et définitivement ironique. À un degré qui va bien au-delà de toutes les échelles de mesure. Et c’est justement cette ironie qui permet de lui attribuer tout autre qualificatif secondaire.
Cette ironie, par exemple, est palpable dans le fait de se poser encore tout un tas de questions plus ou moins existentielles alors que chaque minute de chaque vie est sous le contrôle minutieux d’une ou plusieurs machines. Des distributeurs de rations dosées à la protéine près aux déroulés parfois rocambolesques des spectacles sportifs, des play-lists « personnalisées » dont seul change l’ordre des morceaux proposés aux divers programmes électoraux allant du délégué de classe réserviste-adjoint à la très convoitée présidence du Consortium qui régit la cité, de l’hygrométrie des serres d’où sortent les végétaux composant les rations au contrôle méticuleux des naissances nécessaires, rien n’échappe aux machines. Les transports sont tous automatisés y compris les vélos pour enfants. La fabrication du moindre ustensile nécessite une machinerie dédiée et des processus de contrôle définis par une batterie d’ordinateurs auto-apprenants. Les artistes eux-mêmes sont devenus inséparables de leurs circuits électroniques. Plus personne ne chante ou ne peint réellement. Tout le monde manipule des datas et des algorithmes bien que peu de monde en comprend réellement la teneur.
Aussi, partir loin des machines n’a pas été une partie de plaisir. Il est quasi impossible de se débrancher, même provisoirement. En cas de maintenance — régulière et planifiée — ou pour le passage à un nouveau modèle, il existe un délai « hors contrôle » d’environ cinq secondes. Les connexions sont épiées et testées constamment. Toutes les machines étant reliées entre elles, une sixième seconde sans connexion se transforme aussitôt en alerte générale. Et normalement, c’est à ce moment-là que les ennuis commencent. Autre solution : faire une demande officielle de déconnexion. D’abord, une première série de machines enregistre la demande. Puis, une deuxième série analyse cette demande et fouille d’autres machines pour trouver, examiner, classer et archiver d’éventuelles pièces justificatives. Enfin, une troisième série de machines refuse systématiquement toute demande.
Choisir d’être « hors contrôle » pendant cinq secondes et en profiter pour s’extirper définitivement a relevé du pur concours de circonstances. Nous étions plusieurs à en parler et à réfléchir à des plans plus ou moins aboutis pour sortir de la ville. Et puis quelqu’un s’est rendu compte par hasard que le signal était brouillé à l’approche du canal et qu’il était inexistant à sa sortie, un bassin gigantesque qui sert d’anus à la cité, rejetant à heures fixes le surplus d’immondices et de condamnés à mort en dehors des zones connectées. Nous avons rapidement convenu d’un rendez-vous ici-même, chargés d’un minimum de matériel non électrique. Mais au moment de passer à l’acte, je me suis retrouvé tout seul à attendre l’ouverture de l’écluse.
À côté de la réussite purement procédurale de la déconnexion, il y a cette étrange affection qui ne s’estompe pas. À cause sans doute de l’emprise de l’attache et malgré la volonté de la fuir. Comment en suis-je arrivé à nommer « chaîne » ce cordon avec lequel je suis né et qui m’a nourrit, m’a instruit, m’a socialisé ? À partir de quel moment me suis-je rendu compte qu’en fait, ce cordon ne me préparait qu’à être relié à d’autres cordons ?
J’ai regardé l’eau sale en tentant de me persuader qu’elle l’était moins que ma vie. Je me suis dit : « Je compte jusqu’à trois… » À trente-trois j’ai sauté en fermant les yeux et j’ai laissé le flux m’emporter au gré de son humeur torrentielle. De toute façon, le courant était trop fort pour lutter. Au bout de quelques heures, le débit s’est suffisamment ralenti pour que j’envisage de me poser sur la rive. D’abord dormir. Pas évident de dormir dehors pour la première fois. La nuit est lumineuse et la symphonie des petits bruits est inquiétante. Mais la fatigue l’emporte et je m’écroule à même le sol. Le dernier bruit que j’entends est celui d’une ombre qui détale. Le réveil, ou son absence, me dira s’il s’agissait d’un animal inoffensif et apeuré ou bien d’un prédateur vorace revenu en catimini se repaître d’une proie immobile…
▣