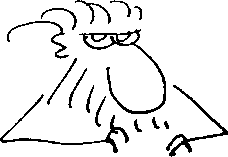« Les parapluies sont des veufs qui portent le deuil des ombrelles disparues. »
Ramon Gomez de la Serna
Nous autres, parapluies, sommes de grands voyageurs. De grands voyageurs involontaires. Nous partons le matin et qui sait où le soir nous trouvera ? Dans quelles conditions ? Et en quel état ?
Parapluies de haute tenue ou bien vulgaires pébroques, nous ne décidons ni du voyage, ni des aléas de ce voyage. Compartiment de première classe ou rame surchargée du quotidien, le hasard est le seul à poinçonner nos tickets. Et, très souvent, ces tickets ne sont que des allers simples au bout desquels beaucoup d’entre nous seront portés disparus.
C’est un aspect méconnu de notre histoire car nous n’enterrons pas nos morts. Nous ne laissons pas d’information sur nos destinations. Malgré une présence quasi millénaire, nous sommes très mal organisés. Pas de syndicat, pas de registre, pas de média influent hormis le cinématographe, cet enfant gâté qui se voudrait sauvage. Car sous les pluies d’Oscars c’est Icare qui s’agite, cet écart majeur d’un art plus que mineur. Mais il est si plaisant d’imaginer partager les joyeuses aventures de la charmante Mary Poppins ! Ou d’être l’accessoire élégant des demoiselles normandes… Ou bien encore, de devenir l’acolyte inquiétant des redoutables espions bulgares !
C’est pourquoi je profite de cette tribune pour raconter mon histoire. Elle est certes banale. Mais c’est ce qui la rend symptomatique de ce que vivent la plupart des parapluies. Nous ne souhaitons ni discours, ni médaille. Qu’en ferions-nous ? Nous souhaitons juste un peu de considération. Un minimum d’attention. Nous ne sommes pas que des abris faciles et provisoires. Nous sommes également des intermédiaires. Combien de belles rencontres avons-nous initié qui sans nous se seraient lentement dépréciées ?
« Un p’tit coin d’parapluie contre un coin d’paradis »
L’atelier où je fus assemblé était une échoppe renommée. N’y arrivaient que des étoffes et des équipements d’une qualité irréprochable. Mes baleines était faites d’un acier à la fois souple et léger mais terriblement résistant. La toile qu’elles manœuvraient était tissée sur un métier de précision puis rendue étanche par des machines étranges. Le mât supportant la mécanique était issu d’un bois rigide lentement tourné par les outils experts d’un ébéniste anglais. Ma poignée était gantée d’un cuir épais cousu par un sellier minutieux. Je trônais dans la vitrine, fier et arrogant, persuadé que seule une main royale — à tout le moins aristocratique — s’en viendrait me quérir.
Je n’eus pas à attendre bien longtemps. La première pluie de l’automne commençait à dessiner ses flaques impressionnistes sur les pavés disjoints de la ruelle quand un bras autoritaire me saisit hors de toute délicatesse. Je fus tourné, retourné, ouvert, fermé puis ouvert encore puis refermé sans le moindre ménagement mais — c’est le plus important — sans la moindre avanie ! Et ce, contrairement à mon prédécesseur qui, toile éventrée et baleines découvertes, gisait au pied du grand comptoir de bois sur lequel je fus débarrassé de mon collier informatif. J’eus à peine le temps d’esquisser une pensée compatissante pour mes frères restés dans la boutique. Je passai la porte et plongeais dans ce monde humide que j’étais impatient d’arpenter !
Je n’oublierais pas ce premier contact avec l’eau ! Ce premier frisson ! J’ai d’abord cru qu’il me signalait un changement de température. Puis je réalisai qu’il était l’expression d’un désir immémorial dont la patience était enfin récompensée. Oh ! Le doux clapotis des gouttes comme des baisers timides sur la toile en tension… Oh ! Ces élancées d’air frais comme des caresses bouillonnantes ! Oh ! L’averse et ses vagues en rafale ! Oh ! L’orage extravagant !
Ma vie de parapluie haut de gamme aurait pu n’être qu’une longue villégiature sereine. De tavernes cossues en hippodromes sélects, de cabriolets italiens en villas de bords de mer, toutes occasions par lesquelles je pouvais croiser les meilleurs parmi mes congénères. Notamment cet ancêtre, le vieux « Canne » et ses invraisemblables histoires de casinos clandestins. À chaque nouvelle rencontre il me semblait un peu plus décati : sa toile était de plus en plus parcheminée, sa mécanique se grippait assez régulièrement, ses baleines décrivaient des courbes trop prononcées mais il savait conserver son élégance et sa faconde. Son charisme de vieil arbre n’en prenait que plus de valeur.
Quand il ne parlait pas casino, « Canne » ne cessait de s’extasier sur les ombrelles qu’il avait eu le bonheur de croiser. Il était intarissable. Il aimait leur mât fin et gaiement coloré. Il appréciait plus que tout les dentelles irisées qui cachaient leurs discrètes aiguillettes. Dentelles que le vent malicieux de l’été faisait danser comme des ombres chinoises envoûtées par le son chaud et profond d’un guzheng millénaire.
L’ombrelle de mes pensées a disparu dans la cohue d’un jour de grève…
Lorsque je la rencontrai, je sortais avec peine de nombreux voyages éreintants qui avaient mis à mal ma bonhommie légendaire et quelque peu froissé mes robustes armatures. Sans beaucoup de transitions, j’étais passé des mains champagnisées d’un coureur invétéré de réceptions mondaines à celles plus malmenées d’un ivrogne du faubourg qui ne m’utilisait que pour retourner la terre et y déloger les larves censées l’aider à attraper les poissons qu’il laissait s’exténuer dans ma toile écaillée ouverte aux quatre vents. Entre ces deux extrêmes, je fus ballotté comme un fétu au gré des chapardages et des emprunts non retournés dont j’étais constamment le pauvre objet d’infortune !
Un homme d’affaires me trouva près d’une table à la terrasse d’une brasserie parisienne près d’un musée de plein air et m’emporta jusqu’à l’autre bout de la ville. Il m’oublia quasi immédiatement dans le hall de marbre froid d’un établissement financier où n’entraient et sortaient que des silhouettes aussi vieilles et grisées que le daguerréotype d’une chaîne de fabrication de machines à clous. L’une de ces silhouettes sembla ravi de me dénicher et m’emmena jusqu’à une station de sports d’hiver. J’étais heureux de découvrir la neige et les montagnes bien que mortifié par le froid cinglant qui faillit bien avoir la peau de mes ressorts ! Mis à sécher près du tas de bois destiné à l’immense cheminée, j’étais étourdi de chaleur. Je sentais le charbon. Je commençais à ne pas envier Jeanne d’Arc quand — hasard ou mimétisme — je fus choisi comme domicile par une bestiole inconnue de moi. Aussi inoffensive que monstrueuse, elle déployait autant de pattes que je dépliais de baleines et passait son temps à tisser des toiles entre moi et les bûches dont la souplesse et la solidité me rendait presque jaloux ! Récupéré après plusieurs jours par le livreur de bois, je passai le plus clair de mon temps dans un camion sale et bruyant qui m’évoquait les tripots de Macao tels que les décrivaient « Canne ». Puis je fus échangé comme une vulgaire verroterie contre quelques rasades d’un alcool rêche sous une teinte ambrée. C’est cet échange qui me transforma en ustensile fouisseur, achevant de diluer le reliquat de dignité que je tentais de maintenir.
Si ce bon vieux « Canne » me voyait ! La colère et la déception l’achèverait certainement. Quelle descente aux enfers ! Plonger dans la boue des terrains vagues de la zone et ne recouvrer l’air libre qu’après avoir ruiné des dizaines de couveuses souterraines ! N’avoir de soins qu’un modeste trempage dans l’eau croupie d’une mare éphémère ! Ne connaître d’abri qu’un sac de toile grossière dans lequel s’accumulait un bric-à-brac d’objets et de chiffons aussi maltraités que je l’étais !
Toutes ces aventures m’avaient considérablement endommagé. Je puais le chanvre humide en décomposition. Ma toile était devenu filandreuse et son imperméabilité n’était plus qu’un triste souvenir larmoyant. Elle témoignait de la rudesse des épreuves endurées. Elle exhibait ses déchirures comme autant de cicatrices profondes et douloureuses. Mes baleines devenues arthritiques étaient rafistolées au grossier fil de fer, responsable d’une bonne moitié des déchirures. Le cuir ouvragé de ma poignée n’était plus qu’une peau de chagrin mal recousue de fil blanc. Si je m’ouvrais encore avec assez de distinction — m’efforçant coûte que coûte à me parer d’une élégance de grand échassier regagnant son abri après la pêche fructueuse qui nourrira son nid — je me refermais avec l’aisance grinçante et claudicante d’une porte de grange à l’huisserie négligée.
Honteux et fatigué, je traînais entre deux sièges de la salle d’attente d’une gare modeste. Peu fréquentée, je commençais à la considérer comme une sépulture acceptable. J’avais été oublié là — peut-être abandonné — par l’ivrogne susnommé. Je me préparais à une fin peu glorieuse sachant qu’elle était l’issue la plus commune pour les utilitaires de notre espèce. Je rassemblais mes souvenirs. Amusés par les uns, attristés par les autres, je tentais de donner une cohérence à ce labyrinthe conceptuel qu’était le puzzle d’une vie.
Elle est entrée au moment où je tentais d’évaluer le vrai du faux dans les récits extraordinaires du vieux « Canne ». Elle tenait en équilibre sur le haut d’une valise à roulettes, ballerine sensationnelle d’un opéra de quatre soupirs, fée parmi les méfaits, Joconde impromptue abolissant Vénus ! Elle figea son sourire quand elle croisa le mien. Je n’ai pas su y lire ce qu’elle me transmettait. Fut-elle apitoyée par ma carcasse dépenaillée ? En a-t-elle pris peur ? Question qui restera sans réponse puisqu’une malle plus épaisse vint buter fortement contre celle qu’elle magnifiait de sa présence. Un choc, une chute, le vide à contempler.
D’autres bagages — dont un gigantesque panier en plastique hébergeant deux pauvres matous effrayés — sont venus encombrer le maigre espace disponible autour des sièges, me plongeant dans une obscurité propice à l’abandon. Le roulement continu du brouhaha occasionné par les allées et venues me rappelait les longs voyages en train de mes jeunes années. Installé très confortablement sur la tablette d’osier entre les somptueux fauteuils en cuir, j’écoutais la pluie frapper sur le carreau avant de s’en aller tomber sur la plaine et je savourais l’étrange nostalgie de ne pas la sentir ruisseler si ce n’est dans les rêves que le balancement régulier du train ne tardait pas à faire naître.
Pour un parapluie, le temps passé est équivalent au temps qu’il fait. Et ce temps est variable. Ordinairement, le beau temps est une monotonie, un temps de dépression. Car c’est le temps des ombrelles. Le temps des frou-frous qui jouent à cache-cache avec les rayons d’un soleil qui nous contraint à l’inutilité. Elles sortent quand nous rentrons. Et lorsque nous entrons en scène, elles se sont déjà mises à l’abri. Nous essaimons comme de lourdes colonies de papillons de nuit quand elles referment délicatement leurs ailes diaphanes de libellules repues de lumière et de vent.
Je garde précieusement enfoui le souvenir des moments lors desquels nous partagions le même porte-parapluie, la même patère, voire — rivage hospitalier à nul autre pareil — le même dossier de bois d’une chaise inoccupée. S’engageait alors un théâtre confus. Étrangement, elles s’y trouvaient souvent en moindre nombre que nous. Parfois seules. Et nous nous querellions pour tenter de devenir l’objet de leur convoitise. Nous étions de jeunes impatients et les impressionner nous paraissait facile. Ne suffisait-il pas d’avoir l’ouverture la plus élégante possible et de la ponctuer d’un clac ! sec et retentissant ? Mais pour les faire rougir, ne fallait-il pas percer les secrets du froissement de la toile et la faire se plier dans un dégradé assourdi de chuintements félins ? Comment fait-on pour apprendre ce qui nous est caché ?
On nous apprend à lutter contre l’orage. On nous conditionne pour être étanche et résistant. On nous ment. On nous force à combattre la pluie. On nous prive de soleil. On nous arrache le cœur et on le remplace par un bulletin météo, lui aussi très souvent mensonger. On nous porte, on nous emporte on nous transporte, on nous supporte et dès lors, nous jouons les importants ! Et puis on nous oublie, on nous maltraite, on nous confond, on nous perd, on nous abandonne. Nous ne sommes que des objets. Des ustensiles. Des utilitaires. Nous sommes non seulement corvéables mais aussi totalement remplaçables. Nous ne laissons ni trace ni empreinte. Juste un exosquelette qui tarde à se biodégrader en compagnie des autres rejetés de la consommation. Nous ne sommes même pas toxiques. Ou si peu.
Un jour, il ne pleuvra même plus. Et la nécessité même éphémère de notre précarité ne sera qu’une image défraîchie dans une archive mal classifiée. Les ombrelles n’auront plus à feindre d’avoir été impressionnées. Peut-être rougiront-elles quand le soleil leur dira comment il a vaincu la pluie et balayé les larges idées noires qui s’ouvraient spontanément à son contact, lourd cortège de nénuphars funestes asséchant une mare croyant la protéger.
Mais pour l’heure, je sens l’humidité me parcourir l’échine. La verrière de la gare est en aussi mauvais état que moi et laisse par endroits la pluie s’infiltrer. Patiente, elle se regroupe au creux des anfractuosités du médiocre béton poreux avant de dégouliner, espiègle et funambule, le long des tuyauteries intérieures. Je m’apprête à prendre cette ultime drache pour un faire-part, une oraison, une onction, un hommage à mon travail infatigable lorsqu’une main trop petite me saisit et me retire de ma cachette avec cette brutalité innocente qu’ont tous les petits êtres qui s’essaient à la vie. Et je me sens rougir quand dans son autre main je la vois empoignée comme un vulgaire paquet de linge qui laisserait entrevoir des soies ordinairement cachées.
Nous sommes traînés sans égard à même le sol sale et détrempé sur un rythme asynchrone qui parfois nous rapproche et parfois nous éloigne l’un de l’autre. Nous sommes projetés contre des valises, des sièges, des souliers. Nous sommes frottés, percutés, piétinés. Ma toile se déchire un peu plus. Une baleine menace de se rompre définitivement. Des coutures abdiquent. Je n’ose plus la regarder, redoutant qu’elle assiste à ma décrépitude, redoutant encore plus de la voir également malmenée.
Mais le destin n’est pas si cruel. Simplement parce que la cruauté est un concept absolument humain. Et lorsque je sens que la pression inégale de la main se relâche, lorsque d’un coup je ne ressens plus cette pression, lorsque je ne ressens plus que le froid du sol, lorsque tout ce que je distingue ne sont plus ses dentelles en haillons mais le son décroissant des petits pas rapides, alors je comprends qu’elle aura peut-être une chance et je m’endors heureux, une chanson dans la tête.
« Un p’tit coin d’paradis contre un coin d’parapluie »
▣