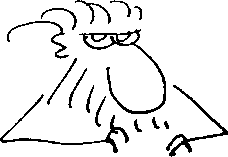J’ai fait un drôle de rêve cette nuit…
Imagine une prison à l’air libre. Les prisonniers y viennent d’eux-mêmes et certains s’y installent à demeure. Aucune trace de grille ou de gardien.
C’est dans cette prison que je me suis rendu. De grands bâtiments carrés aux murs blancs surmontés d’une toiture bleue, uniforme.
Si tu ne l’as pas déjà reconnue, pas de suspens : cette prison, c’est Facebook.
Et pourquoi rêvé-je de Facebook ? Parce que depuis un moment, l’idée d’y ouvrir un compte me travaille.
Il y a dans cette idée autant de bonnes raisons que de raisons liées à la simple curiosité. Il y a surtout le fait (et ça, ça m’inquiète !) que le Chien est en train de regagner du terrain sur un Loup fatigué de cette liberté sauvage pour laquelle, visiblement, il ne semblait pas fait.
Le fait aussi que ces trois dernières années, durant lesquelles la faim, le froid et la solitude se sont invitées régulièrement, ont été particulièrement difficiles.
Donc, parmi les bonnes raisons qui me feraient ouvrir un compte Facebook, il y a le fait que je ne désespère toujours pas de trouver un boulot en relation avec le grand Internet. Et bosser sur Internet sans connaître Facebook c’est un peu vouloir être maître-nageur et avoir peur de l’eau. Déjà que je ne connais pas Windows… ! Le fait aussi que de plus en plus d’amis proches y sont connectés.
J’en suis toujours là de mes hésitations mais se poser la question c’est déjà un peu y répondre et en toute honnêteté, la décision d’ouvrir un compte est quasiment déjà prise. Ne reste plus qu’à le faire vraiment. Et espérer que ça ne se passe pas comme dans mon rêve !
Mon rêve, donc.
La pluie rendait le sol glissant et donnait aux murs un aspect gris sale. Le bleu de la toiture semblait par contre plus intense, se confondant parfois aux teintes d’encre sombre d’un ciel triste à pleurer. Des gens affairés et indifférents à mon statut de nouvel arrivant se croisaient dans un désordre apparent, s’arrêtant parfois pour se scruter puis reprenaient leur errance formicide.
Comme prévu, mes amis vinrent me chercher sur le patio central. Souriants et heureux de nous voir, nous échangeons quelques banalités pendant que je me laisse conduire dans un dédale de larges bâtiments rectangulaires tous semblables. Devant l’un d’eux, nous poussons une porte et pénétrons dans une cantine immense. Des tables en gros bois non nappées à perte de vue. Des bancs de chaque côté d’icelles. Des marmites gorgées d’un plat unique — sorte de ragoût de haricots et de navets baignant dans un jus jaunasse et bouillonnant — étaient disposées sur certaines tables autour desquelles une foule bruyante venait mécaniquement y remplir des écuelles ébréchées. Je goûte. Je trouve ça ni bon, ni mauvais. L’impression d’avoir bien mangé mais d’avoir encore faim : l’estomac est satisfait mais les papilles sont en manque. À la suite de cet étrange repas collectif où tout le monde mange debout — malgré les bancs — nous ressortons de la cantine et longeons des coursives reliant les bâtiments ce qui nous met en partie à l’abri de la pluie.
Un des bâtiment arbore quelques lumignons colorés autour de son unique porte d’entrée que nous ne franchissons pas. Pour une raison inconnue, la porte coulissante se déclenche à intervalles parfaitement réguliers mais personne, absolument personne, ne songe ni à entrer ni à sortir.
Après avoir contourné d’autres bâtiments, nous arrivons sur une place épargnée par la pluie. Le sol est fait d’un sable compacté d’un jaune assez proche du ragoût sur lequel des tracés blanchâtres délimitent les « chambres ». La mienne se trouve à l’autre extrémité de la place près d’un arbuste assez curieux : pleins de fruits rouges aux formes bizarres faisant se ployer des branches fines et sans feuilles. Je m’allonge sur un lit fait de gravier et m’endors.
Je suis réveillé par les hurlements hystériques de types lisant chacun et à très haute voix, un livre différent ! Je me lève précipitamment et remarque un quai de gare derrière le muret qui sépare la place ensoleillée du reste de ce monde où la pluie, toujours, continue de tomber. Je m’approche du quai et décide de prendre le train qui y stationne. Je cherche vainement un panneau qui indiquerait la direction de ce train, voire l’heure de son départ. Des centaines de personnes déambulent sur le quai. Certaines montent dans un wagon puis en redescendent aussitôt. D’autres s’accrochent, essoufflées et hagardes, aux montants de fer de chaque côté des portes grandes ouvertes comme si elles venaient de s’agripper in extremis au tout dernier train. Je patiente sur le quai lorsqu’une voix familière me fait un signe de la main. Je veux la suivre mais je suis incapable de bouger, fasciné par la sarabande des voyageurs qui semblent attendre depuis mille ans que ce train veuille bien partir !
La même voix, à nouveau. Je me retourne et le paysage est devenu d’un blanc aveuglant ! Plus aucun bâtiment, plus de pluie, plus de place !
Fin du rêve.
Ce matin, je me suis levé de bonne heure. Le soleil était déjà chaud et le café n’allait pas tarder à l’être. Je pense encore réfléchir avant de m’inscrire.
▣