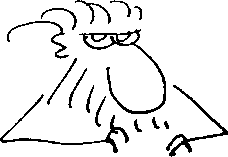Introduction
Le premier juin 1967, sortait l’abum « Sgt Peppers’ Lonely hearts Club Band » des Beatles. Cet album n’a pas, à lui seul, révolutionné la pop-music mais jamais le qualificatif de « pierre angulaire » n’a été à ce point mérité. Cet album contient à la fois un état de l’art au moment de sa publication et la plupart des chemins encore vierges d’exploration qu’arpenteront par la suite, et avec plus ou moins de bonheur, les musiciens des générations suivantes.
J’avais donc préparé ce texte pour qu’il sorte le 1er juin 2017… Pour un tas de bonnes raisons aujourd’hui oubliées, je n’ai pas pris le temps de le terminer et il s’est retrouvé enfoui dans la masse compacte des textes en jachère qui hantent les circuits de mon ordinateur. Une récente exploration de cette masse compacte a permis d’exhumer celui-ci. Retravaillé pour l’occasion.
Tu peux bien sûr écouter l’album original pendant ta lecture mais garde à l’esprit que ce qui suit n’en est pas un compte rendu. Juste une libre interprétation.
Nothing stops my mind from wandering…
Aux bons soins de Mr. Kite
Toute existence, quelque soit sa durée, possède cette journée particulière qui a tout changé. Un jour dans une vie. Pour moi, c’était il y a… quarante-huit… quarante-neuf… cinquante… C’est bien ça. Ça fait exactement cinquante ans, quasiment jour pour jour, que je ne suis pas revenu dans cette partie de la ville. Ce n’est ni un oubli ni une superstition. Pas même un manque de temps. Je n’ai simplement pas envie de regarder en arrière. À quoi bon contempler le passé ? Si c’est pour se lamenter, se morfondre, culpabiliser, regretter, promettre que si c’était à refaire… À l’inverse, si c’est pour s’en réjouir, en tirer de la fierté voire de la vanité… Rien de bien positif ne peut survenir quand on passe son temps à se chercher dans un rétroviseur. Je crois qu’il faut laisser s’évanouir tranquillement ce qui ne peut de toute façon pas être changé. Ni dans les faits ni dans leurs conséquences. Le passé appartient aux musées et aux cimetières. Parfois aux casiers judiciaires…
Le lendemain de cette fameuse journée, j’ai d’abord pensé fuir le pays pour aller m’installer à Paris, près de la Tour Eiffel. Mais j’avais à peine de quoi faire le voyage. Je garde néanmoins l’idée dans un coin de ma tête en me disant qu’un jour la fortune me sourira. Pour le moment, cette idée ne fait sourire que les copains du pub qui me font systématiquement payer la tournée dès que je prononce les mots « Paris » ou « Tour Eiffel ».
Il y a donc cinquante ans, je me résolus à déménager le plus loin possible d’un quotidien devenu l’expression la plus utlime de l’insupportable. Le plus loin possible, à cette époque, signifiait simplement passer de l’autre côté de l’estuaire. C’était bien suffisant pour changer de vie. Le temps de découvrir d’autres pubs… et y reprendre les mêmes habitudes. Surtout, laisser la mémoire, peu à peu, se faire oublier en floutant les images du passé. Au point de souscrire à ce voyage pour « seniors » qui me fait retraverser la Mersey pour la première fois depuis un demi-siècle.
Ce voyage, je l’ai booké au tout dernier moment, en rentrant du pub, et je n’ai pas pris le temps de checker en détail son itinéraire. Sinon, j’aurais probablement renoncé. Mais maintenant que je suis installé sur l’impériale du bus… alea jacta est ! comme disait Jules César quand il s’asseyait à la table d’un casino. Du coup, je pense à la Tour Eiffel. Née d’une idée improbable, cette tour a d’abord engendré le chaos avant de s’inscrire durablement dans un paysage dont elle est aujourd’hui le symbole. Et le chaos qui m’a fait fuir cette partie de la ville est aujourd’hui unanimement reconnu comme une plaine fertile. Une source intarissable d’émerveillement pour tout un chacun. Y compris, désormais, pour moi.
En débarquant du ferry, et avant de prendre le bus, j’ai quand même eu une demi-seconde d’hésitation. Mais, outre le fait que ce voyage n’était pas remboursable, la nostalgie sait se rendre aguichante. Elle te prend par le bras et te raconte des anecdotes enjolivées de sa voix calme et chuchotante. Tu essaies de ne pas l’écouter mais déjà tes pupilles s’allument d’un feu étrange. Tes lèvres serrées s’alanguissent soudain pour former un sourire entendu. Te voilà piégé. Et ravi de l’être.
À l’approche de « mon » quartier, de « ma » rue, de « ma » maison, je ne peux empêcher un frisson me parcourir de la tête aux pieds en un aller-retour aussi fugace qu’étincelant. Revoir la maison du voisin, surtout, me touche plus que je ne l’aurais imaginé. Tant d’années et si peu de changements, hormis l’absence dudit voisin. Le gravier mauve a pâli mais il sépare toujours les deux habitations. Deux constructions de briques lasses qui se souviennent peut-être qu’elles ont été, l’une un volcan, l’autre un champ de bataille. Bien calé dans la foule qui se tasse sur l’impériale du bus, je verse quatre larmes discrètes qui iront se perdre dans le vent. D’autant plus discrètes qu’une pluie fine et délicate met la ville sous cloche. Ses gouttelettes virevoltent plutôt qu’elles ne tombent et tentent maladroitement d’éviter la toile sombre des parapluies s’ouvrant à leur approche comme de gros nénuphars en deuil. Ou comme un lourd tapis d’encre de Chine qui attend l’eau de l’aquarelliste pour se magnifier en un gigantesque théâtre d’ombres.
C’est l’heure où l’activité trépidante de la ville est censée s’affaiblir. Mais le dernier embouteillage tarde à se résorber et permet aux avertisseurs désaccordés des limousines poussives de faire durer leur dissonante et inutile cacophonie. Du haut de l’impériale, je me revois tel que j’étais, un demi-siècle plus tôt, conducteur taciturne dans ce flot immobile, suivant distraitement l’évolution du score sur ma vieille radio aigrelette. Je conduisais alors un véhicule ayant deux fois l’âge de mon whisky préféré mais deux fois moins d’autonomie qu’une jarre de celui-ci. Une berline familiale de bas de gamme qui traînait sa misère de rouille dans un concert de vrombissements et de cliquetis, évoquant tour à tour la perte d’un sac de billes dans un grand escalier aux marches grinçantes puis le climax de la saison des amours chez les grillons subsahariens. Quand elle n’évoquait pas la fanfare hallucinée de mon curieux voisin, le grandiloquent Monsieur Poivre.
Monsieur Poivre avait emménagé dans la maison voisine un premier juin. Ce jour-là, je tentais de contenir ma colère en colmatant un trou dans la toiture par lequel l’eau s’écoulait jusque sur des rosiers que je négligeais depuis si longtemps qu’ils n’étaient plus qu’un informe buisson dardant ses épines aux quatre points cardinaux. Un peu comme ces nuques chevelues qui commençaient à envahir la ville. Et c’est du haut de l’échelle que je vis débarquer Monsieur Poivre et ses malles colossales.
Monsieur Poivre était un homme constamment jovial. Pluie, neige, vent, contrôleur du fisc, rien ne pouvait le départir de son éternel sourire communicatif. Toujours aimable, toujours prêt à rendre service. Serviable à l’excès, même, diront plus tard d’autres voisins plus médisants. Monsieur Poivre se disait artiste, sans plus de précision, attisant d’autant plus la méfiance dévolue aux nouveaux arrivants. Le voisinage n’allait d’ailleurs pas attendre bien longtemps pour se faire une plus ample idée de l’art de Monsieur Poivre car celui-ci était chaque jour en train d’expérimenter une nouvelle prouesse — quelles qu’en pouvaient être les conséquences —pour s’en aller ensuite recueillir, faussement naïf et véritablement curieux, les avis des habitants les plus proches. Avis très largement défavorables, faut-il le préciser. Mais Monsieur Poivre n’en tenait aucun compte. Ce qui l’intéressait essentiellement était de provoquer une réaction. Qu’elle fût positive ou négative revenait au même. L’indifférence, la neutralité ou l’indécision quant à ses « œuvres » étaient ses plus farouches ennemies. Il allait vite devenir ce voisin infernal, celui qui allait transformer en cour de récréation pour monstres et orchestre un quartier d’ordinaire plus feutré que l’arrière-boutique d’un chapelier de Covent Garden !
Tradition oblige, il fallait bien entretenir une amabilité de façade avec ce personnage qui paraissait pouvoir lire à travers les âmes sans jamais s’offusquer de ce qu’il y découvrait. Étrange et inquiétant, étaient les qualificatifs qui le désignaient le plus absolument. Certains étaient allés jusqu’à changer leurs habitudes pour ne pas risquer de le croiser. Mais j’étais son voisin le plus immédiat et je n’avais pas toujours de possibilité d’esquive.
— Bien le bonjour, Monsieur Kite, mon cher voisin !
(Ce « mon cher voisin » bien apuyé par lequel il me saluait me faisait l’impression d’une prise de possession sur ma personne et me mettait mal à l’aise.)
— Bien le bonjour, Monsieur Poivre ! Vos expérimentations avancent-elles comme vous le souhaitez ?
(J’espérais à chaque fois qu’il m’en annonce la fin.)
— Ne me parlez pas de ces maudites expérimentations, voulez-vous ? Au moins jusqu’à ce soir. Le temps de résoudre un petit problème de sonorisation.
(Le dernier « petit problème » de sonorisation avait provoqué une crise d’hystérie chez les pensionnaires du collège, à trois rues d’ici !)
— Mais je euh… mais bien sûr, Monsieur Poivre. Je euh… je comprends tout à fait.
(Rester poli. Ne pas le brusquer. Réprimer l’envie de m’enfuir en courant.)
— Merci Monsieur Kite. J’étais certain que vous comprendriez. Entre artistes, forcément.
(Ce « forcément » ressemblait fortement à l’obligation de choisir son camp.)
— Euh… je… forcément, bien sûr.
(What else? Je peux partir maintenant ? Please…)
— D’ailleurs, ce soir je vous invite ! Si vous ne rentrez pas encore à des heures plus que tardives !
(Mais… il m’espionne ! Trouver rapidement une excuse différente des précédentes !)
— Ha, ce travail me tuera, Monsieur Poivre. Tenez, ce soir, nous recevons nos lointains fournisseurs et nous ne pouvons pas les laisser errer seuls dans la ville, n’est-il pas ?
(Et l’Oscar de l’excuse la plus pourrie est attribuée à…)
— Il est, Monsieur Kite, il est. En ce cas, ce sera pour une autre fois. Rassurez-vous, j’ai toujours quelque chose à montrer aux amis.
(Il n’est pas dupe et ne me lâchera pas tant que je n’aurais pas accepté.)
— Je euh… je n’en doute pas, Monsieur Poivre, je n’en doute pas une seule seconde. Bien, je vous dis à un de ces prochains soirs, alors.
(Courage, fuyons !)
— Cher Monsieur Kite, je mettrais les bouchées doubles rien que pour vous ! Je vous dédicacerais la séance de ce soir. Mais je le ferais discrètement. Cela pourrait créer des jalousies, n’est-il pas ?
(Des jalousies ? Je vais surtout me faire lyncher par tout le quartier, pauvre fou !)
— Cela me gêne énormément, Monsieur Poivre.
(Help! I need somebody! Help!)
— Allons, allons. Pas de chichi entre nous, Monsieur Kite. Le spectacle de ce soir sera pour votre bien, foi de Monsieur Poivre !
Ne pouvant alors ni déménager, ni me faire héberger, j’empruntais chaque soir l’itinéraire le plus long possible afin de rentrer chez moi le plus tard possible en espérant que ce diable de voisin se soit enfin couché le plus tôt possible. Ce qui n’était pas arrivé depuis des semaines. Je me levais hagard. Je travaillais au ralenti — quand je travaillais. Je passais directement au pub en sortant du bureau. Je choisissais systématiquement les avenues encombrées. Je roulais bien en-deça de la vitesse limite autorisée, me faisant parfois doubler par des cyclistes inquiets et des piétons hilares. Une fois dans mon lit, le peu de temps que je pouvais dormir c’était pour voir mes rêves envahis par les créations de Monsieur Poivre.
Car dès que le soir tombait, la maison de Monsieur Poivre devenait le théâtre apocalyptique d’un spectacle inouï. Aux premiers signes avant-coureurs, les volets du voisinage claquaient leur désapprobation ! Et parce qu’ils n’étaient pas autorisés à y assister, les enfants désobéissants et les adolescents rebelles se donnaient rendez-vous sur les toits pour tenter d’en grappiller des miettes. La lune, toujours aux premières loges, veillait de son halo discret à tamiser la scène. Le vent lui-même s’immobilisait pour ne pas en troubler les derniers préparatifs. Le chant des merles n’était plus qu’un chuchotement allant decrescendo…
Puis le silence…
Et soudain, des larges fenêtres aux huisseries fatiguées s’échappaient des cohortes de sons terrifiants poursuivies comme leur ombre par des à-plats de couleurs brutalement électrisées. Des roulements de tambours assourdis s’empressaient depuis la cave pour ne pas manquer d’accompagner chaque chute de tuile ou de branchage consécutive aux passages répétés des tornades conceptuelles que Monsieur Poivre jetait deci-delà pour en tester l’attrait. Sortant des cheminées comme des diables d’une boîte à ressort, des trompettes enjouées tentaient d’apprendre à voler aux tuiles qui résistaient. Alangui sur le perron, un gros chat roux et gris aux pattes uniformément absentes imitait à la perfection la joie communicative du chien courant après le chat et était aussitôt rejoint par les hurlements jaloux des cabots alentour. Des trains ivres de charbon se téléscopaient sur les murs et se changaient aussitôt en hirondelles grâcieuses s’en allant —avec entrain —peupler le ciel de multiples diamants. Des mainates exigaient d’être immédiatement remboursés ! Une enclume suspendue à des ballons de baudruche gonflés au vent d’hiver, récitait des poèmes sans rime et sans mot. Monsieur Poivre, depuis son flamboyant habit de cérémonie et debout dans le jardin, lançait des étoiles imbibées d’ambroisie aux fées venues pour l’applaudir. Enfin, il enfourchait un cheval ailé garé en double file et s’en allait préparer son prochain spectacle à l’abri des rêves à peine éclos que la pluie du matin refusera de noyer.
Et le même spectacle se répétait tous les soirs, agrémenté, selon l’humeur de Monsieur Poivre, de quelques variantes sonores et lumineuses. Les soirs d’orage, la foudre venait jouer en guest star et le quartier se trouvait plongé dans le noir pour une partie de la nuit. Les soirs de matches, notamment quand les Reds dominaient la rencontre, c’était un coulis de fruits rouges qui empourprait les ruelles autour de la maison. Les soirs de pleine lune, des gens, pour la plupart inconnus du quartier, apparaissaient soudain et transformaient le jardin de Monsieur Poivre en une piste de danse sur des sables mouvants, infranchissables et émouvants, avant de disparaître les uns au travers des autres jusqu’à ce que l’ultime silhouette se confonde avec l’ombre des arbres alignés le long de la rue.
J’étais fatigué de tout ce cirque. Ma petite vie confortable venait tout juste de voler en éclat et la dépression était seule candidate à vouloir combler le vide. J’étais dans un état si hirsute que mes collègues ne m’approchaient plus. Je faisais peur aux rares commerçants chez lesquels je me rendais encore. Plusieurs fois, la préposée aux parcmètres de la rue est venue aux nouvelles, me suggérant sans aucune délicatesse de prendre quelque repos dans une maison spécialisée. « Ça finira par aller mieux… », m’assurait-elle en se rhabillant prestement. Je l’avoue : j’avais des envies de meurtre. Je me voyais déjà justifier mon geste au tribunal au nom de la santé mentale des habitants de ce quartier résidentiel dont l’âge moyen avoisinait les soixante-quatre ans.
Un soir que j’étais plus ivre que d’habitude, j’échafaudais un plan pour me débarrasser de mon encombrant voisin. Ce plan, je l’imaginais ridiculement simple. De toute évidence, il était simplement ridicule.
Pour commencer, je payai une tournée générale. Ce qui reste la méthode la plus sûre si l’on souhaite un peu d’aide de ses amis. Ils n’étaient pas nombreux mais ils formaient une escouade fière et fiable. Parmi eux, les frères Henderson. Récemment virés du club de rugby pour avoir assommé la moitié de leurs coéquipiers suite à un différend sur la possible meilleure distillerie des Highlands. Des forces de la nature capables de porter un bœuf vivant. Capable aussi d’en manger un chacun à chaque repas ! Ce vieil Henri, ensuite. « Riton le Cheval », comme l’appelaient les habitués. Le patron du pub. Turfiste émérite mais éleveur contrarié. Je leur expliquai mon plan. Je leur réexpliquai. Ils ne comprenaient rien parce qu’ils étaient plus saoûls que moi mais ils promirent, moyennant une nouvelle tournée, de me filer le coup de main demandé.
Le lendemain, je sortis plus tôt du bureau et alla directement au pub. Après quelques tournées pour nous donner du courage, nous prîmes la direction de la maison de Monsieur Poivre avec la ferme intention — au moins pour ma part — de le faire disparaître avant que ne commencent ses festivités car c’était le seul moment où il n’était pas entouré. À chacun son tour de jouer au presditi… au pretidi… au magicien, Monsieur Voip… Monsieur Proiv… Monsieur mon voisin !
Premier accroc dans mon super plan : un trajet est plus long lorsqu’il est fait en titubant. Et qu’on prend certaines rues dans le mauvais sens. Aussi, avant même d’arriver épuisés au seuil de sa demeure, nous savions que la fête battait déjà son plein. Monsieur Poivre s’affairait à défourner une immense tourte aux herbes et champignons pour l’anniversaire de Lucy, la fille cadette de son vieil ami tchadien. Loin d’en être contrarié, il se félicita de notre venue impromptue et, après nous avoir saoûlé de ses trop exquises politesses, il nous fit servir un apéritif dans des tasses incandescentes au fond desquelles des pastilles colorées retardaient leur descente. Puis il nous proposa de partager son repas. Je sentis bien le piège et tentai de refuser poliment. Alors que je reculai pour m’éloigner de la zone d’influence de Monsieur Poivre, je trébuchai sur le rebord du bassin et me retrouvai le cul entre les roseaux et les carpes sous un éclat de rire général. Et tandis que mon plan achevait de prendre l’eau, je contemplai tristement mes amis se soumettre, extatiques, aux charmes conjoints de la tourte et des yeux de Lucy.
Des yeux qui ressemblaient comme deux gouttes d’or aux forges souterraines d’où provenaient les plus rares des pierres les plus précieuses ! À chaque battement de ses cils — comme une ombre furtive sur un lac irisé — des arcs-en-ciel s’accouplaient et faisaient naître chaque fois une teinte nouvelle. Les rayons de soleil qui s’y bousculaient en un chahut permanent, en étaient éjectés plus chauds, plus dorés, plus mielleux.
En un claquement sec de ses doigts fins de pianiste russe en exil, Lucy fit redescendre du ciel les milliers d’hirondelles qui la veille s’y étaient réfugiées. Tandis que la majeure partie d’entre elles tournoyaient en désordre au-dessus de la fête improvisée, certaines — méticuleusement choisies par Lucy elle-même — agrippèrent à pleine patte les revers de vestons des frères Henderson et les emmenèrent en croisière autour du jardin de Monsieur Poivre dans lequel une végétation tropicale exubérante s’entretenait avec les nuages d’altitude à propos d’une possible histoire d’amour entre la mer et le vent. Des frissons cornéliens, tout droit sortis des entrailles encore chaudes d’un revendeur de pointes, se firent la courte échelle pour improviser un ballet aux accents circonflexes. À mon tour accaparé par la danse immobile de Lucy, je ne songeais même pas à m’extirper du bassin.
Les hirondelles ne reprirent leur envol vers leur écrin de ouate que lorsque tout le monde se fut rassemblé à même le gravier mauve qui séparait ma maison de celle de Monsieur Poivre. Ce dernier confia avec appréhension son cheval ailé à Lucy en échange d’une promesse de retour à chacun des anniversaires de chacune des hirondelles. Ce n’est que lorsque la silhouette de la jeune fille s’évapora totalement dans le lointain que le silence reprit possession du jardin.
À me voir ainsi, totalement abattu, un hêtre compatissant se transforma en saule mais ses larmes se cristallisèrent sitôt sorties de son écorce. Elles tournoyèrent un moment, comme en apesanteur, puis se laissèrent emmener, résignées, par une pluie soudainement torrentielle qui fit le bonheur des guérisseuses gitanes, invitées permanentes aux fêtes de Monsieur Poivre. Elles dissimulaient des fioles de pur cristal dans les longues manches de leur coutil de lin et purent ainsi renouveler leurs stocks. Depuis la nuit des temps, elles fabriquaient secrètement des breuvages et des onguents avec diverses eaux de pluies qu’elles mêlaient d’herbes rares. De la pluie de l’été pour effacer les chagrins laissés par la pluie du printemps. De la pluie de l’automne pour s’habituer peu à peu aux longues pluies de l’hiver. Par sympathie — et peut-être aussi pour tester de nouvelles préparations — elles proposèrent de m’enduire de lotions, de potions et de décoctions. Une pincée de ces pommades suffisait normalement à réveiller un mort mais mon cœur solitaire était devenu un sol imperméable.
Ça n’était bien sûr pas le cas auparavant. Mais un matin qui ne semblait pourtant n’avoir rien de particulier, hormis être précisément le matin qui vit l’arrivée de Monsieur Poivre, une lettre griffonnée à la hâte et posée — plus sûrement jetée — sur la table de la cuisine changea instantanément deux êtres bien vivants en deux statues de pierre froide.
« Je m’en vait. »
Sans autre explication. Avec son incorrigible orthographe.
Tu t’en vas… Mais tu vas où ? Comment ? Avec qui ? Pourquoi ? Pourquoi toi ? Pourquoi nous ? Pourquoi maintenant ? Tu rentres quand ? Tu n’es encore qu’une enfant…
Elle n’est jamais rentrée. N’a jamais donné de nouvelles.
Quelques jours après que notre fille se soit enfuie de la maison familiale, ce fut autour de sa mère de quitter le domicile commun, me laissant dans une solitude peuplée d’idées noires et de nuits blanches. Solitude entrecoupée, depuis l’arrivée de Monsieur Poivre, de tourbillons chromatiques inséminés de parfums abrasifs. Depuis que la petite était partie, je n’ouvrais plus la bouche que pour y mettre des bières ou du mauvais whisky. Ce qui ne faisait qu’accentuer un état de délabrement psychologique devenu insurmontable. Surtout, cela accréditait à mon insu les soupçons de mon épouse quant à ma responsabilité intégrale dans le départ de notre fille. Après tout, n’avait-elle pas été cette mère exemplaire dont rêvent tous les enfants ? C’était donc forcément de ma faute. Aussi partit-elle à son tour, transformant le calendrier en une succession ininterrompue de novembres frisquets.
Et puis un jour, sans qu’aucun signe précurseur ne le laissât deviner, Monsieur Poivre s’en alla. Il rassembla ses affaires dans deux immenses malles en osier qu’il chargea sur une carriole attelée à un cheval placide. Monsieur Poivre s’en alla tout aussi discrètement qu’il était arrivé : en apostrophant tout le voisinage à qui il distribuait des salutations sincères mais tonitruantes. « Bien le bonjour ! Bonne journée ! Bonjour ! » répétait-il sans malice à toute personne ou animal qu’il croisait.
Je me sentis soudainement à la porte d’un nouvel enfer, sans cri, sans couleur et sans joie. Je voyais des jours vides succéder aux jours creux. Des jours creux succéder aux jours interminables. Je ressentais le néant qui m’enrobait déjà de bandelettes badigeonnées de suie pour me momifier quasi intégralement. Le cerveau ruiné, le cœur à sec et le foie plein d’alcool.
Un inattendu sursaut — éclair de lucidité ou simple instinct de conservation — me fit déménager à mon tour dans les jours qui suivirent.
Il y a cinquante ans de cela, quasiment jour pour jour, Monsieur Poivre est entré dans ma vie avec le fracas du météore s’en allant pourchasser les derniers dinosaures. Ma vie s’est brisée à ce moment précis mais, à son insu — encore que de sa part, il fallait bien s’attendre à tout — il m’a ouvert l’esprit. Il m’a appris à regarder plutôt qu’à voir. Depuis, sans aller jusqu’à m’enthousiasmer pour tout, je n’hésite pas à prêter attention aux diverses performances artistiques qui semblent naître et disparaître instantanément comme des feux follets indécis dans un cimetière urbain. Je commence à apprécier les ébauches de peinture là où d’autres ne voient que des gribouillis d’enfants gâtés voire des salissures d’enfants perdus. Je m’attarde et me surprends à contempler la brise sitôt qu’un son nouveau sort d’un nouvel instrument. Je tente de comprendre l’art infini des couleurs.
Le bus s’arrête devant une échoppe de souvenirs et la foule se presse pour s’encombrer des mêmes écharpes, des mêmes porte-clefs, des mêmes photographies. Je reste assis. J’ai des souvenirs pour dix générations. De vrais souvenirs forgés à même la chair. Une chair morcelée, en partie disparue et jamais revenue. Mais qui cicatrise étonnament vite. Je ne me pose plus la question de leur retour ou de leur vie présente. Par contre, j’aimerais bien savoir ce qu’est devenue Lucy. Monsieur Poivre est-il toujours de ce monde ? Encore aujourd’hui, quand je m’apprête à juger avant que de comprendre, je ressens sa présence. Je le vois droit comme un I majuscule dans son bel habit rouge. Je revois les locomotives sur le mur se changer en oiseaux délicats. Je revois les yeux de Lucy égrenant des accords silencieux pourtant chargés d’amour. Peut-être que ces absences font partie de la leçon ?
Aujourd’hui, tout compte fait, je me sens apaisé. La pluie a cessé. Mes co-passagers reprennent leur place en se montrant leurs emplettes avec fierté. Les mêmes écharpes, les mêmes porte-clefs, les mêmes photographies… Mais qu’importe ? Je vais m’approprier le leitmotiv de Monsieur Poivre, celui qu’il prenait tant de plaisir à prononcer en ouverture de ses « expérimentations », avec la gourmandise du camelot d’expérience devant une assemblée d’acheteurs émerveillés : « A splendid time is guaranteed for all! »
▣