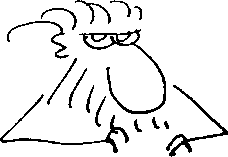Ne fais pas attention au titre, il n’a aucun rapport avec le sujet. J’étais à court d’idées pour en trouver un et ce soir FIP a eu la bonne idée de retransmettre un concert d’Alice Russell. Une merveille.
À part ça, je voulais te parler de deux livres en particulier. Deux romans. Ce qui est assez inhabituel chez moi puisque, je pense te l’avoir déjà dit, je goûte assez peu les romans. Ces deux livres, que j’avais lu il y a assez longtemps, ont repris depuis peu leur place dans la pile des livres en cours. Avec d’autres (dont je te parlerais plus tard), ils constituent la première tranche de documentation nécessaire à mon projet. Ce sont par contre les deux seuls romans de cette liste.
Au moment de les ramener de la bibliothèque, et alors que je ne les avais pas encore passés sous le scanner qui me les appropriera pour quelques semaines, je me suis posé la question de leur légitimité dans la pile que j’avais constituée et qui commençait à peser lourd dans le sac. Leur poids n’était pas en cause puisqu’ils étaient assurément les plus légers du nombre ! Mais peut-être étaient-ils les plus lourds en terme de passif ?
Pourquoi relit-on un livre ? Surtout quand on en connaît déjà l’histoire. Car même si nous croyons ne plus nous en rappeler, les premières lignes nous remémorent assez vite l’ensemble du texte, de manière fragmentaire, certes, mais suffisante pour reconstituer et les intrigues et leurs galeries de personnages. Relit-on pour le plaisir de retrouver de belles phrases joliment agencées de mots rares et tissées sur le fil d’une conjugaison audacieuse ? Mais dans ce cas, on ne relit pas vraiment de A jusqu’à Z. On feuillette, on se promène, on s’attarde, on batifole dans le hasard des pages, comme le faisait Henri III les soirs d’encanailleries.
Il doit y avoir à peu près autant de réponses qu’il y a de lecteurs et de lectrices… et tant mieux !
Pour ma part, ces deux livres représentent chacun en leur genre, une part de ma mémoire disparue. Celle après laquelle je cours comme un canard sans tête…
L’un me remonte une vieille et improbable histoire de porte quand l’autre se complaît dans la méta-mémoire collective qui est notre bien commun. Notre source.
Loin de m’aider à retrouver les pièces manquantes de mon puzzle, ces deux livres me signalent l’emplacement des trous et me laisse augurer de leur abyssale profondeur à l’aune de la difficulté que j’éprouve à m’en détacher complètement. L’attirance pour le vide n’est peut-être que le désir de rebrousser chemin ? Comme on ferait demi-tour sur la route des vacances pour vérifier que l’on a bien fermé le gaz.
Ces deux ouvrages sont des traductions. L’un d’un auteur américain, l’autre d’un auteur anglais.
Le premier roman, du fait d’avoir un auteur américain (devenu par la suite francophile), se trame le long d’une description aussi clinique que possible, pointue et rigoureuse, qui adopte parfois un angle par trop misérabiliste et qui manque sérieusement d’humour. Le talent narratif de l’auteur y instille cependant une fraîcheur et une originalité qui compense très largement l’atmosphère pénible et angoissante qu’on peut ressentir à sa lecture, notamment quand celle-ci vous replonge dans votre propre mais indicible chaos…
Le second, parce qu’anglais, déborde de cet humour drôle et intelligent qui caractérise la culture anglaise. D’un autre côté, l’auteur abuse vraiment de cette autre caractéristique anglaise qui est la mysoginie outrancière, gratuite, méchante et systématique. La garantie scientifique de l’ensemble (l’auteur est anthropologue) et la dérison globale du regard qu’il pose sur ses contemporains permet de passer outre ce défaut et de se cultiver en se marrant, ce qui est plutôt rare !
L’un raconte l’incompréhension d’un enfant qui n’a pas encore, et pour cause, le même référentiel que les adultes sur ce qui peut-être bien ou mal mais qui se le voit reprocher de la pire des façons. L’autre, plus jovial, franchement hilarant, prétend que les tares de nos sociétés ont toujours existé et qu’elles ont comme origine l’irréconciliable antagonisme entre les besoins strictement nécessaires à la survie collective d’un groupe d’individus et les envies particulières des individus de ce groupe qui tendent à les éloigner du groupe.
Dans les deux cas, deux mondes s’affrontent sans qu’aucun ne puisse sortir vainqueur, chacun ayant ses règles, inconnues ou incomprises de l’autre. L’univers sans limite d’un enfant contre le monde étriqué des adultes, la conservation de l’acquis contre la recherche du progrès.
Un monde d’adultes n’est finalement qu’un ancien univers d’enfant encombré d’interdits arbitraires et de règles obscures. Alors que les acquis d’une société ne sont, par définition, que d’anciens progrès réalisés puis figés au point de devenir des contraintes, voire des règles obscures, auxquelles seul un nouveau progrès permettra d’échapper… provisoirement ! Pour un enfant, la seule échappatoire possible, la seule ayant une viabilité potentielle en terme de survie, est l’imagination, seule capable de créer ou de recréer des univers sans limite à partir d’une broutille, d’un rien, d’un fétu.
Qu’est-ce que le bruit d’une porte face au tonitruant vacarme du monde ? Mais en revanche, qu’a-t-il de si tonitruant le vacarme du monde puisqu’une porte peut l’assourdir ?
Le battement soudain de cette porte et ce sont des mois, peut-être des années, d’empreintes mémorielles qui se sont échappées, laissant béant le vide immense entre les deux rives d’un fleuve que nul pont ne relie. Se sont-elles écoulées lentement par de discrets interstices, comme l’eau qui goutterait à l’embase d’un robinet ou se sont-elles dispersées avec furie comme un marc qui fuirait le tonneau d’un seul coup percé par mille haches soiffardes ?
Un jour, ici, dans ce lieu bien précis, à Paris, et dès le souvenir suivant, là-bas, un autre lieu, en banlieue, à mille lieues d’un milieu jusque-là naturel…
Dans ces conditions, retrouver ce qui est advenu à partir de ces frêles ressouvenances, ressemble à ces hypothèses paléoanthropologiques, constamment discutées, débattues, parfois corroborées, proches d’être validées pour aussitôt être remises en cause par la découverte d’un nouvel os, d’un bout de molaire à l’émail presque intact, d’un semblant de rogaton d’éclat de silex à partir duquel on reconstituera — ô merveille ! — les habitudes alimentaires et les gestes de chasse de primo-hominidés sans pour autant préciser s’ils étaient supporters de Liverpool ou amateurs de calembours…
La science ne délivre pas tout.
Fouiller l’intimité d’une personne ou décrire la saga d’un groupe, de l’infiniment petit à l’infiniment grand, il s’agit toujours de la même histoire. Celle d’un Homme est forcément celle de tous les Hommes, et inversement.
Notre propre histoire conditionnera la façon de nous approprier l’histoire collective mais pas d’y échapper. En ce sens, il est peut-être plus facile, de remonter aux sources collectives pour ensuite tenter de redescendre le fleuve particulier de sa vie plutôt que l’inverse. Savoir ce qui nous est commun pour mieux comprendre ce qui nous est particulier.
« cogito ergo sum » et « scio qui sumus » sont dans un bateau… pourvu qu’aucun des deux, jamais, ne tombe à l’eau ! (C’est du latin de cuisine trouvé sur le Web, juste pour faire mon intéressant… si ça se trouve, ça ne veut strictement rien dire !)
- Howard Buten : Quand j’avais cinq ans je m’ai tué.
- Roy Lewis : Pourquoi j’ai mangé mon père.
▣