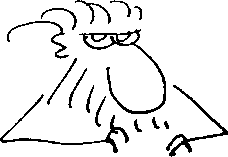Au-delà (bien au-delà) de la responsabilité pénale qui ressortira du procès en cours sur les attentats contre Charlie-Hebdo, se pose cette effroyable question : que faire de cet esprit « bête et méchant » qui est une part intrinsèque et inaliénable de notre psychologie humaine ?
Il est inutile de se cacher derrière l’adoption d’une philosophie ou d’une religion pour se croire définitivement civilisé. Il est tout aussi inutile d’argumenter la convivialité, la bienveillance ou l’esprit de tolérance pour se croire immunisé contre nous-mêmes. Fondamentalement, nous avons toutes et tous, dans un ou plusieurs recoins de notre esprit complexe, des images bien plus « hardcore » que ces piètres caricatures qui n’ont été qu’un prétexte à déchaîner une folie assassine. Des images mais aussi des intentions, des processus, des idéaux. Que — fort heureusement — peu d’entre nous mettons réellement en œuvre. Hormis quelque sombres individus dont tu peux ici insérer le nom si tu as un dictateur préféré, qu’il soit chef d’état ou chef d’entreprise.
Ce ne sont pas tant les victimes de massacres qui valident l’horreur desdits massacres mais cette capacité intrinsèque de les perpétrer. Cette menace perpétuelle de Big Bang émotionnel peut surgir à tout moment et pour toute déraison, en fonction de paramètres aussi infimes qu’intimes, définissant un taux de sensibilité ou d’agressivité que nous sommes incapables de maîtriser complètement.
Massacrer du vivant est plus qu’une seconde nature. C’est un critère essentiel de notre évolution, non seulement en tant qu’espèce zoologique mais surtout en tant que groupe social. Massacrer de l’infiniment grand — les grands arbres des forêts primaires — et de l’infiniment petit — l’hygiénisme qui prétend se débarrasser indifféremment de toute bactérie. Exterminer ce qu’on ne comprend pas. De la fourmilière au fond du jardin dont l’exploration s’étend parfois aux placards de la cuisine et aux pots de confitures mal protégés jusqu’aux pays voisins ou lointains parce qu’on ne supporte pas leurs prières ou leurs danses, parce qu’on en jalouse la richesse ou la topographie ou, plus simplement, parce qu’on redoute leur équipe de football ou leur cuisine trop épicée. Quand ce n’est pas simplement pour se défouler et se délecter de la mort des autres ou se rassurer sur une prétendue virilité qui doit être bien faible s’il lui faut toute cette violence pour se sentir exister.
D’ordinaire, dans le monde plus pacifique et plus ordonné qu’est la jungle, la vraie — et en dehors de certaines facéties purement alimentaires — les inévitables conflits opposant les êtres vivants se résolvent pratiquement tous par le verbe. Rhétorique, insulte, cri, aboiement, froissement d’ailes, le vivant possède tout un arsenal sonore pour faire entendre son point de vue. Mais la psychologie des êtres humains se construit aussi (surtout ?) sur des points de non-retour. Et lorsqu’elles s’accouplent, bêtise et méchanceté proposent assez vite un parcours fléché vers ces points de non-retour, une sorte de grand appel mystique à l’auto-destruction, un ultime contrepoint d’orgue pour que se déchaîne une violence irréparable.
Ces deux faces d’une même médaille résident en nous comme un terreau plus ou moins fertile ou comme des braises plus ou moins ardentes — selon que l’on a déjà eu, ou non, recours à leurs capacités de nuisance. Bêtise et méchanceté pourraient bien être une forme exacerbée de l’option suicide dont sont équipés certains groupes d’êtres vivants. Exacerbée dans le sens où cette option ne serait pas une conséquence mais un but. Une façon de graver puis d’entériner une présence éphémère, nocive mais remarquée. La signature arrogante d’un méfait avant de prendre la fuite.
Car ce combo « bêtise plus méchanceté », ajouté à notre impréparation fondamentale à la vie en commun — à la vie, tout simplement — aurait dû nous éliminer rapidement de la liste des vivants et nous ranger définitivement au rayon des fossiles inexploitables. Visiblement, ça n’a pas été le cas. D’une part, parce que l’espèce entière ne s’est jamais retrouvée au cœur d’une même spirale infernale mais seulement, ça et là, à tour de rôle et de façon aléatoire, des groupes ou sous-groupes d’icelle. D’autre part, parce qu’il existe des mécanismes de compensation propres à enrayer l’autodestruction globale de cette société d’apprentis bipèdes foncièrement provocateurs et maladroits.
Et parmi ces mécanismes — outre un instinct de conservation efficace bien qu’excessivement malmené — figure en bonne place l’invention de la civilisation. Pour paraphraser mon ami Jean-Jacques Rousseau, il est probable que le premier — plus vraisemblablement la première — qui a dit Bon, ça suffit les conneries, on va instaurer quelques règles.
, celui-ci, ou celle-là, a inventé la civilisation. Je crois fermement — parce que je suis un vieux con iconoclaste à réflexion unilatéralement binaire — que la notion de civilisation n’existe que pour contrecarrer cette bêtise et cette méchanceté qui sont ce qui nous sépare vraiment de l’animal. Et qui sont peut-être la raison pour laquelle le règne animal nous a demandé d’aller voir sur un arbre plus loin s’il n’existait pas une branche de l’évolution plus susceptible d’accueillir nos incohérences de vertébrés différemment cérébrés.
Ici, il faut considérer rapidement deux théories sur l’expansion de l’humanité. La première nous dit que l’humanité serait née quelque part en Afrique de l’Est, sans apporter toutefois de géolocalisation précise. Elle serait issue de la division d’un groupe de primates et aurait peu à peu colonisé l’ensemble de la planète par migrations successives en s’adaptant chaque fois à un nouvel environnement. L’autre prétend que la présence de l’être humain sur toutes les terres du globe n’a été possible que parce que plusieurs groupes déjà essaimés d’un même primate auraient connu une évolution commune. À mon humble avis, la première théorie est à la fois la plus intéressante et la plus probable. D’abord parce que nous avons d’abord été des animaux et avant cela de simples êtres vivants et que le modèle d’expansion des êtres vivants est, me semble-t-il, celui du groupe unique qui grandit, se divise et s’étend. Ensuite parce qu’une évolution commune au sein d’environnements différenciés s’apparente davantage au funambulisme théorique qui caractérise l’économie libérale contemporaine.
L’invention de la civilisation a permis l’optimisation de capacités spécifiques à cette nouvelle espèce : langage articulé, développement technologique, organisation sociale modulable. En retour, ces capacités ont permis l’optimisation des civilisations. Mais le principal atout de cette humanité naissante, celui qui lui a permis de survivre collectivement autant aux luttes internes qu’aux dangers périphériques, a été sa capacité à se reproduire de façon anarchique. Parfois même, de façon bête et méchante. Quelque soit la saison et la place sociale des individus dans le groupe. Ne pas dépendre d’un calendrier, d’un couple alpha ou d’une lignée stricte pour assurer une descendance a forcément aidé à ne pas voir sa population décliner au gré de ses mésaventures. Par exemple, il devenait possible de tester toute sorte de nourriture sans risquer l’extinction. Oh ! Un champignon…
Et, hop : au suivant !
Il devait faire bon être lion ou léopard à cette époque. Ainsi que charognard. La chair était facile, fraîche et de quantité. Comme pour ces ours qui se postent au milieu de la rivière, la gueule grande ouverte, attendant que s’y jettent les saumons qui remontent le courant. Ou ces politiciens aux abords des banques suisses pendant la saison des amours des rétrocommissions. On peut aussi se demander si, d’un point de vue strictement écologique, ce n’était pas le premier rôle de cette nouvelle espèce : servir de proie peu farouche et néanmoins régénérante à des prédateurs sur le déclin. Puis disparaître. Pour réapparaître aux profits de nouveaux prédateurs malades.
Quoi qu’il en soit, cette espèce a fait mieux que perdurer et il a bien fallu pour cela qu’elle s’organise un minimum. Qu’elle prenne conscience de ses actes. Qu’elle les hiérarchise, les catégorise, les priorise. Qu’elle trie le faste du néfaste. Qu’elle échappe indéfiniment — et à la suite de chaque nouvelle manifestation de bêtise et de méchanceté aux conséquences tout aussi imprévisibles que catastrophiques — à sa condition préétablie d’espèce provisoire. Comme un programme informatique qui oublierait de se fermer à la fin de son exécution suite à une infime mais terrible erreur de programmation.
Depuis le tout début, bêtise et méchanceté sont à la source de toutes les épopées humaines. Un yin et un yang de bruit et de fureur. Un couple de Thénardier en charge d’une Cosette d’eau et de forêts.
Regarde autour de toi. Elles accompagnent tant de situations quotidiennes qu’on finirait presque par s’y accoutumer. Conflits armés, multinationales, patriarcat, échec scolaire, indifférence à la misère, communautarisme religieux, blockbusters hollywoodiens, paillettes télévisuelles, chroniqueurs aigris, lâcheté anonyme sur les réseaux sociaux, violences policières, publicité et marketing… Partout. Tout le temps.
Incendier, massacrer, inonder, torturer, fracasser, violer, raréfier, piller, estampiller, acculturer, enchaîner et puis recommencer. Passer au deuxième groupe. Saisir, punir, ternir, avilir ! Ne jamais ralentir ! Se réjouir de découvrir un troisième groupe ! Vouloir apprendre. Comprendre comment transmettre un savoir. Et puis se satisfaire du pouvoir de détruire !
L’extension des religions monothéistes a nucléarisé la famille autour d’un patriarche dont le rôle est calqué sur un divin égocentré et punisseur. Mais être roi en son royaume n’est pas satisfaisant sur le long terme. Ailleurs, l’herbe est plus verte, la peau noire plus rentable et l’eau claire moins vitale. Alors il faut sans cesse conquérir de nouveaux territoires, il faut sans relâche soumettre des populations, il faut coûte que coûte industrialiser le moindre processus. Il faut sans honte et sans remords polluer les esprits et les corps.
Bêtise et méchanceté te présente leur fils, nommé capitalisme.
En ce sens, avoir réussi à transférer bêtise et méchanceté sur un terrain exclusivement culturel afin d’amuser ses contemporains sans pour autant renoncer à les faire réfléchir, aura été la vraie réussite des fondateurs d’Hara-Kiri, prédécesseur mensuel de Charlie-Hebdo. Ses contempteurs lui reprochaient de flatter nos instincts primaires avec ses articles d’une mauvaise foi assumée, ses jeux de mots rigolards et gratuits bien que très souvent sexistes et racistes, ses images pornographiques et dégradantes, sa raillerie systématique de toute forme de pouvoir. Instincts primaires, comportements primitifs, art premiers. Un vaste retour aux sources en version ludique et non filtrée. Une version pour rire. Pour sourire. Avant d’en mourir.
Très curieusement, au moins pour un français aimant jouer sur les mots, on remarque que le terme japonais hara kiri est la version populaire du fameux et aristocratique seppuku, le suicide rituel des samouraïs qui consiste à s’ouvrir le ventre pour se purifier l’âme. Je ne sous-entends évidemment pas que les tireurs venaient en purificateurs. Sauf, peut-être, pour eux-mêmes. Mais d’une manière plus globale, cette intuition pour bien nommer un journal qui fut essentiel à son époque, semble aller au-delà du simple hasard. Comme si nous avions un écriteau interne ne ratant pas une occasion pour se signaler à notre attention et nous ramener à nos improbables origines chaotiques. Ou un panneau lumineux en fonctionnement permanent que nous tenterions sans succès de camoufler par des lumières plus vives : flash des appareils photographiques, puissance des projecteurs de cinéma, persistance des néons des grandes villes, aura des gurus, influence des écrans.
Sœurs siamoises liées par les lambeaux incandescents de nos mémoires inatteignables, bêtise et méchanceté sont sur un bateau. Ivres de rage et de folie. Insensibles à la beauté. Indifférentes à l’univers. Elles tracent un sillon d’autant plus acéré qu’on tentera de le combler. D’autant plus profond qu’on essaiera de l’oublier. Et nous n’avons aucune alternative. S’y soumettre bêtement ou résister méchamment semble n’avoir aucun effet. Elles sont maîtresses du jeu. Les millénaires s’écoulent mais les comportements stagnent. La durée de vie augmente mais les angoisses ne diminuent pas, laissant plus de place aux cauchemars qu’aux rêves.
L’utopie transhumaniste est peut-être inconsciemment née de ce constat : quitter la Terre et la chair pour se refaire à neuf. Mais couper les ponts n’empêche pas les rivières de couler.
Hiver 2095. Un binôme de transhumains fondamentalistes fait dévier de son orbite l’un des principaux complexes scientifiques autour de Jupiter pour protester contre le remplacement des antiques processeurs à chaleur tournante par de nouveaux connecteurs quantiques. L’implosion des douze modules a causé la perte inestimable des cent vingt-cinq robots explorateurs « nouvelle génération ». D’après la direction de la Transgalactic Illimited, propriétaire du complexe, la destruction de ces condensés de sophistication est un crime contre la bio-électronique et risque de plonger l’ensemble des galaxies dans un obscurantisme rappelant les heures les plus sombres des proto-civilisations pré-robotiques
tandis que les assistants terriens non augmentés chargés de la maintenance de nos robots seront vite remplacés, nos usines de clonage tournent toujours à plein.
▣